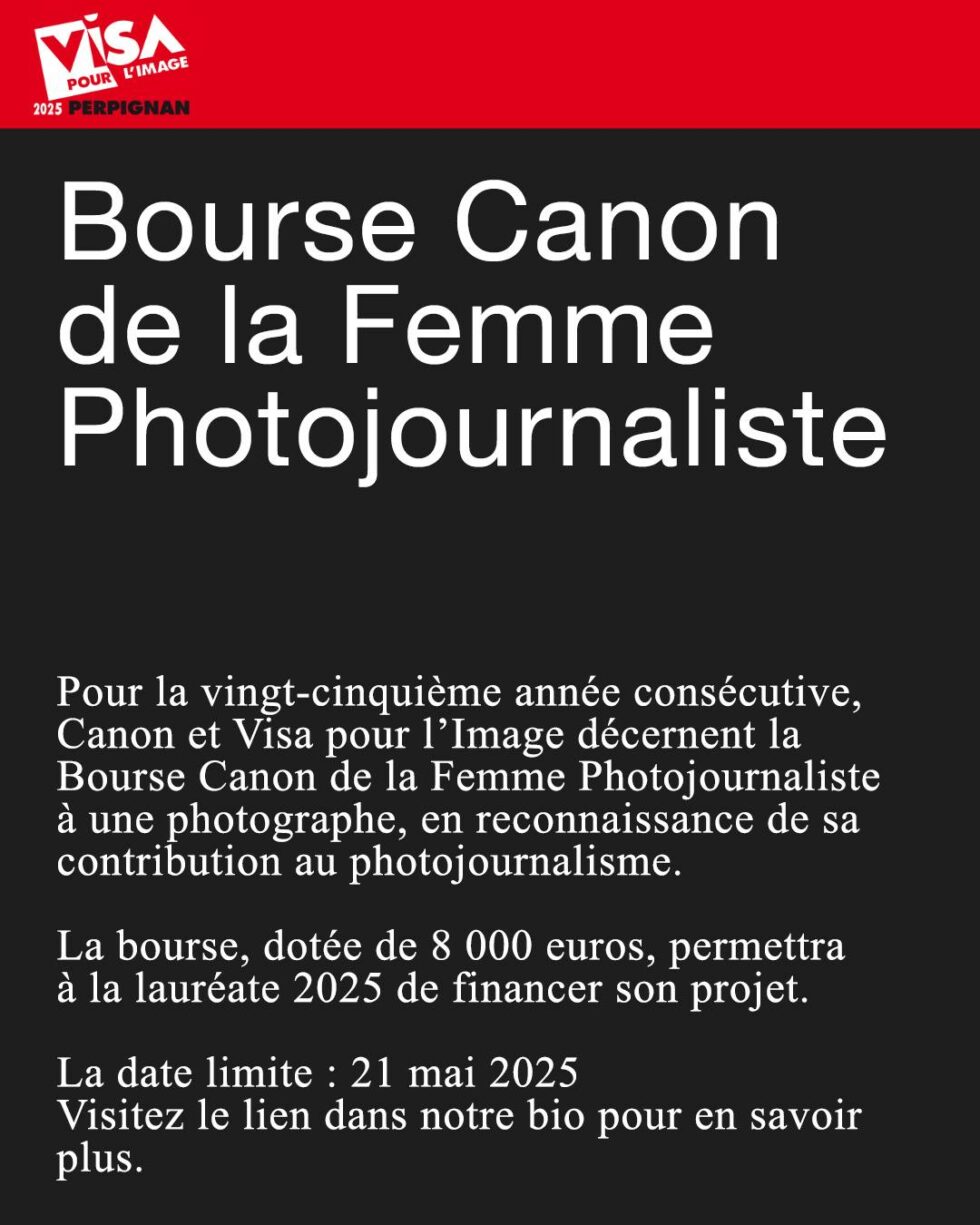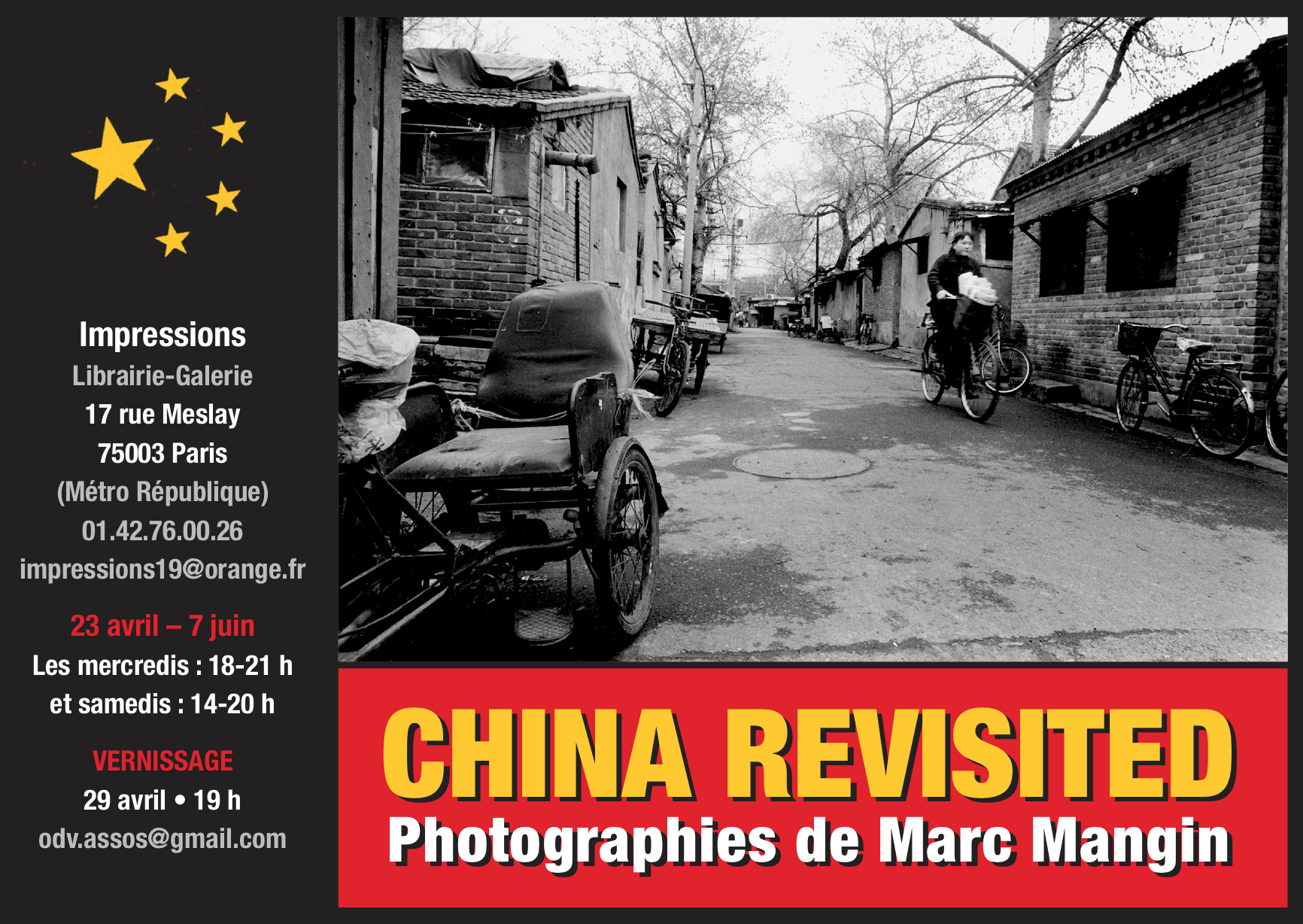Un jour, alors que je finissais le montage d’A ciel ouvert, le scénariste Jérôme Tonnerre m’a apporté un livre sur un photographe. Parmi les magnifiques photographies, certaines m’étaient familières mais je n’avais pas retenu le nom de celui qui les avait faites : Gilles Caron.
En feuilletant les dernières pages du livre, je découvrais qu’il avait disparu brutalement au Cambodge à l’âge de trente ans et j’étais saisie par la présence dans un de ses derniers rouleaux de pellicule, de photos représentant ses deux petites filles. Je retrouvais comme en miroir les dessins que ma mère peintre, Clotilde Vautier, avait faits de ma sœur et moi enfants peu avant sa mort en 1968 alors qu’elle avait, elle aussi, à peine trente ans.
Ces photos étaient comme un appel, une invitation à faire un film. J’ai alors voulu rencontrer les différents membres de sa famille, pour comprendre ce qu’il était advenu des recherches sur la disparition de Gilles Caron au Cambodge en 1970. J’ai appris qu’elles étaient restées vaines et qu’il était inutile de vouloir enquêter sur place. Ce n’était pas de ce côté que le film pourrait aller.
Et puis, très vite la Fondation Caron a mis à ma disposition les 100 000 photos numérisées faites par Gilles Caron dans sa fulgurante carrière. Face à cette masse gigantesque de photos, j’ai commencé par m’intéresser au reportage d’où est issue la célèbre photo de Cohn-Bendit face à un policier en 1968. J’ai alors essayé de comprendre précisément quel avait été le trajet de Caron dans les quelques mètres carrés qu’il avait sillonnés ce jour-là. J’ai eu l’impression d’être avec lui, derrière son épaule et c’est à ce moment-là que le désir du film est devenu évident, impérieux.
Déchiffrer des images pour percevoir au travers d’elles la présence de leur auteur, était quelque chose que j’avais déjà exploré dans le film sur ma mère Histoire d’un secret (2003). Histoire d’un regard est né de ce même désir de faire revivre un artiste à partir des images qu’il nous a laissées et exclusivement à partir d’elles. La préparation J’ai commencé par observer les planches-contacts de tous ses reportages.
Je me suis alors rendu compte que leur numérotation était aléatoire et qu’elles n’avaient jamais été classées dans l’ordre où elles avaient été prises. Pour comprendre le regard de Caron, il fallait avant tout que je remette en ordre les rouleaux de chaque reportage. Pour effectuer ce classement et pour reconstituer les déplacements du photographe, je me suis documentée sur chacun des événements et des personnages pris en photo, je me suis plongée dans les cartes des villes que Caron avait parcourues ou, quand les villes avaient changé, je suis allée jusqu’à reconstituer leur plan ; j’ai croisé les rouleaux faits au même moment avec différentes focales ; je me suis appuyée sur des détails qui devenaient de véritables indices : des ombres sur le sol, une tache sur un mur, un objet dans la main d’un des personnages…
Ce travail d’enquête et de repérages quasi archéologique a duré plusieurs mois et il m’a permis d’aiguiser mon regard sur les photos, de comprendre les cheminements à la fois physiques et intérieurs de Gilles Caron, ses questionnements, ses découvertes, ses doutes. Par cette immersion intense, j’ai eu l’impression d’être à ses côtés, de revivre avec lui ces instants, et plus important encore, de percevoir quelque chose de ses choix de photographe.
L’écriture
Pour écrire le film, j’ai dû évidemment prendre de la distance avec ces centaines d’informations, d’analyses, d’anecdotes, toutes aussi intéressantes les unes que les autres et avec les 100 000 photographies observées. Ce qui nous a guidé, moi et mon coscénariste Jérôme Tonnerre, dans l’écriture et la structuration du film, c’était mon désir de redonner vie au regard de Gilles Caron. Caron n’a pas étudié la photographie mais malgré cela, il est devenu très vite un très grand photographe.
De par sa culture générale, artistique et politique, de par ses qualités physiques, du fait aussi que comme ancien appelé de la guerre d’Algérie il savait trouver sa place dans les situations de conflit. Mais ce qui a fait son talent, sa spécificité, c’est son regard sur les gens, sa manière de saisir la singularité des individus bien au-delà des événements dont ils étaient les protagonistes. Dès ses premiers reportages, il fait des photos extrêmement fortes qui seront publiées partout. Il est rapidement envoyé dans les lieux de conflit importants et c’est donc sur le terrain, qu’il va être confronté à toutes les grandes questions que la pratique du photoreportage peut engendrer. Gilles Caron n’était pas un théoricien et il n’a pas eu le temps d’écrire sur son expérience mais ses questions relatives à son travail sont là inscrites dans ses photos, au fil de ses reportages.
C’est pourquoi, pour raconter son regard, il m’a semblé important de respecter la chronologie de ses photos. Il fallait rester au plus près de l’intimité de son travail, raconter ses questionnements, « mine de rien » sans analyse didactique. Au spectateur d’aller plus loin, de prolonger l’analyse à partir des indices que j’allais lui laisser. Un récit à la première personne Comme dans mes autres films, il s’agissait pour moi de comprendre l’autre en me plongeant dans son regard et sa manière de voir le monde. Mais ce qui s’est peut-être modifié au fil de mes réalisations et qui influe de plus en plus sur mon mode de narration, c’est l’envie de mettre en évidence par la mise en scène ce déplacement du regard vers l’autre. Car c’est au fond ce déplacement qui me semble être l’expérience artistique et politique essentielle à vivre et faire partager à chacun d’entre nous.
C’est pourquoi depuis Histoire d’un secret, je suis de plus en plus présente à l’image, par la voix ou dans la manière de filmer. C’est aussi pour cette raison que j’ai eu envie que mon enquête sur Caron, ma subjectivité soient présentes dans le film à travers des scènes et à travers mon récit. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer un film qui aurait ignoré mon propre regard cherchant le sien. Et six mois de travail et de côtoiement des images m’ont amenée tout naturellement à m’adresser directement au photographe et à le tutoyer.
La forme
Dès l’écriture du scénario, je voulais que la manière de rencontrer le photographe et ses photos soit différente selon les reportages et les émotions qu’ils suscitaient. C’est pourquoi les dispositifs narratifs et visuels changent au cours du film. Par exemple j’ai décidé de me rendre en Irlande pour rencontrer ceux et celles que Caron avait photographiés car j’ai eu la sensation que lors de ce reportage il s’était senti, plus que d’autre fois peut être, en accord avec cette lutte. Jamais il n’avait fait autant de photos en si peu de temps. Alors, toujours dans cette idée de me mettre dans ses pas, je suis allée vers ceux et celles dont cinquante ans plus tôt il avait tenté, plus qu’à son habitude, de s’approcher.
Cette liberté formelle était pour moi essentielle. Je ne voulais surtout pas d’un montage systématique. Avec la monteuse Agnès Bruckert, nous ne nous sommes d’ailleurs donné que deux règles. La première, à laquelle nous n’avons dérogé que très rarement, était de ne pas trahir le cadrage du photographe. Et l’autre de ne pas assujettir les photos à l’illustration historique, à l’information journalistique. Les photos devaient redonner vie à Gilles Caron, à son regard, son désir et au final nous embarquer dans un récit. C’était d’ailleurs à mon sens la manière la plus juste de faire vivre le travail de Caron : il y avait chez lui un désir de construire des histoires avec des personnages, même au cœur des événements les plus dramatiques. Je voulais par le montage, le traitement du son et la musique mettre en évidence cette dimension narrative, cinématographique et romanesque qui caractérise, selon moi, le travail et la trajectoire de Gilles Caron.
Mariana Otero
Tous nos articles concernant Gilles Caron
Dernière révision le 5 janvier 2024 à 8:03 am GMT+0100 par
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi


 Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ?