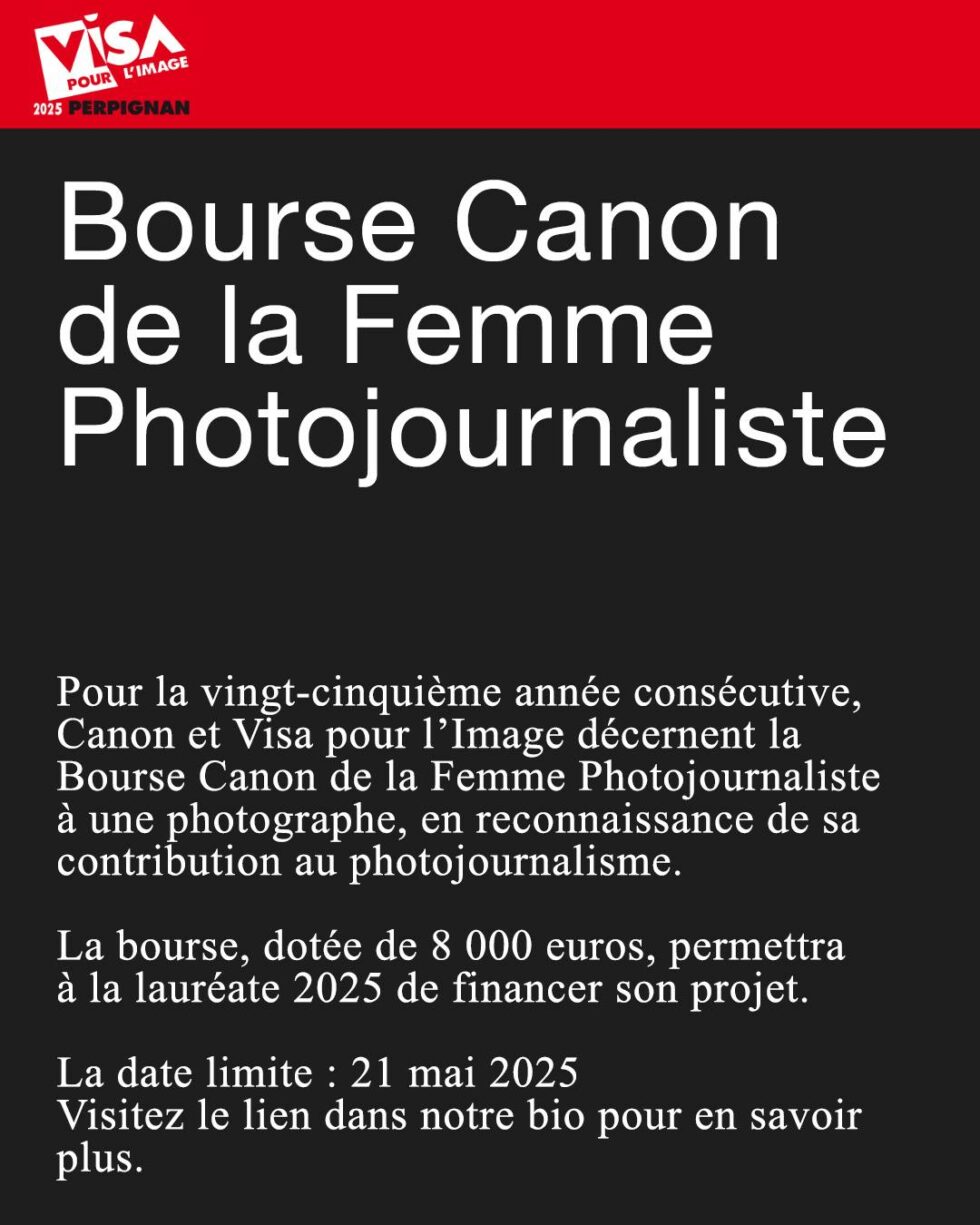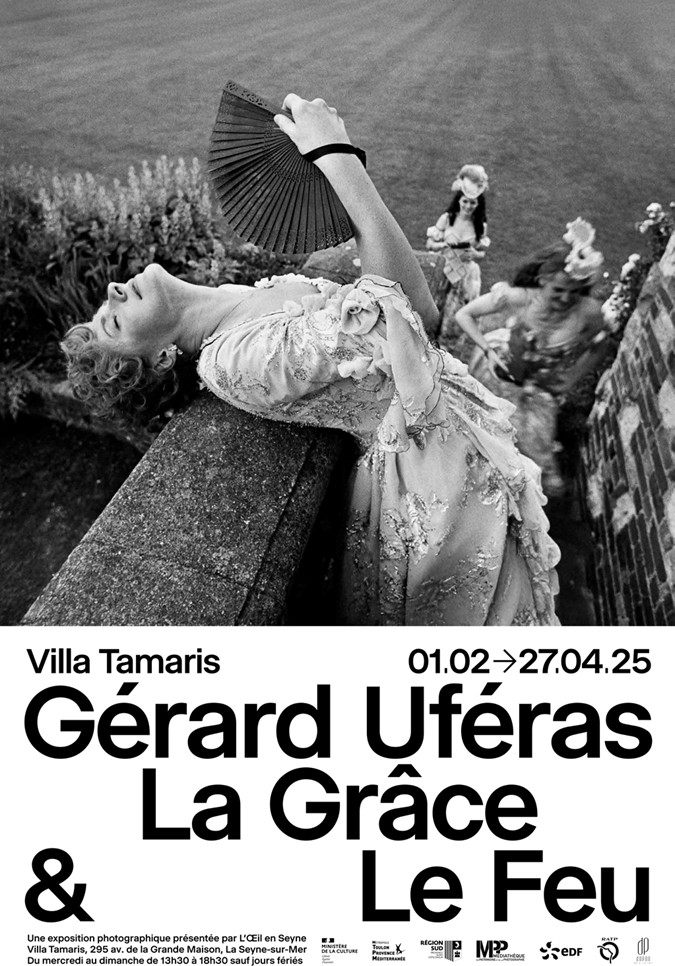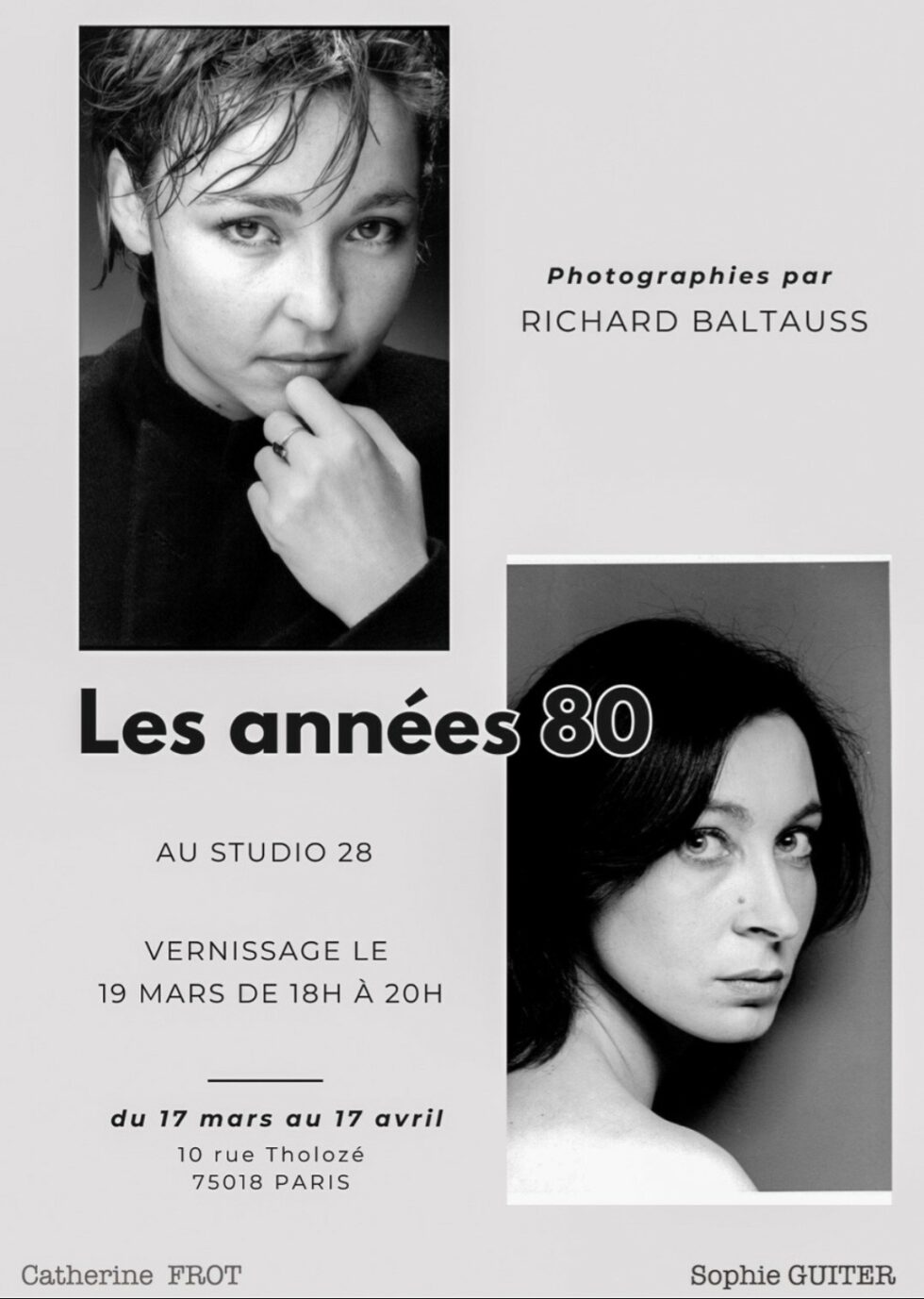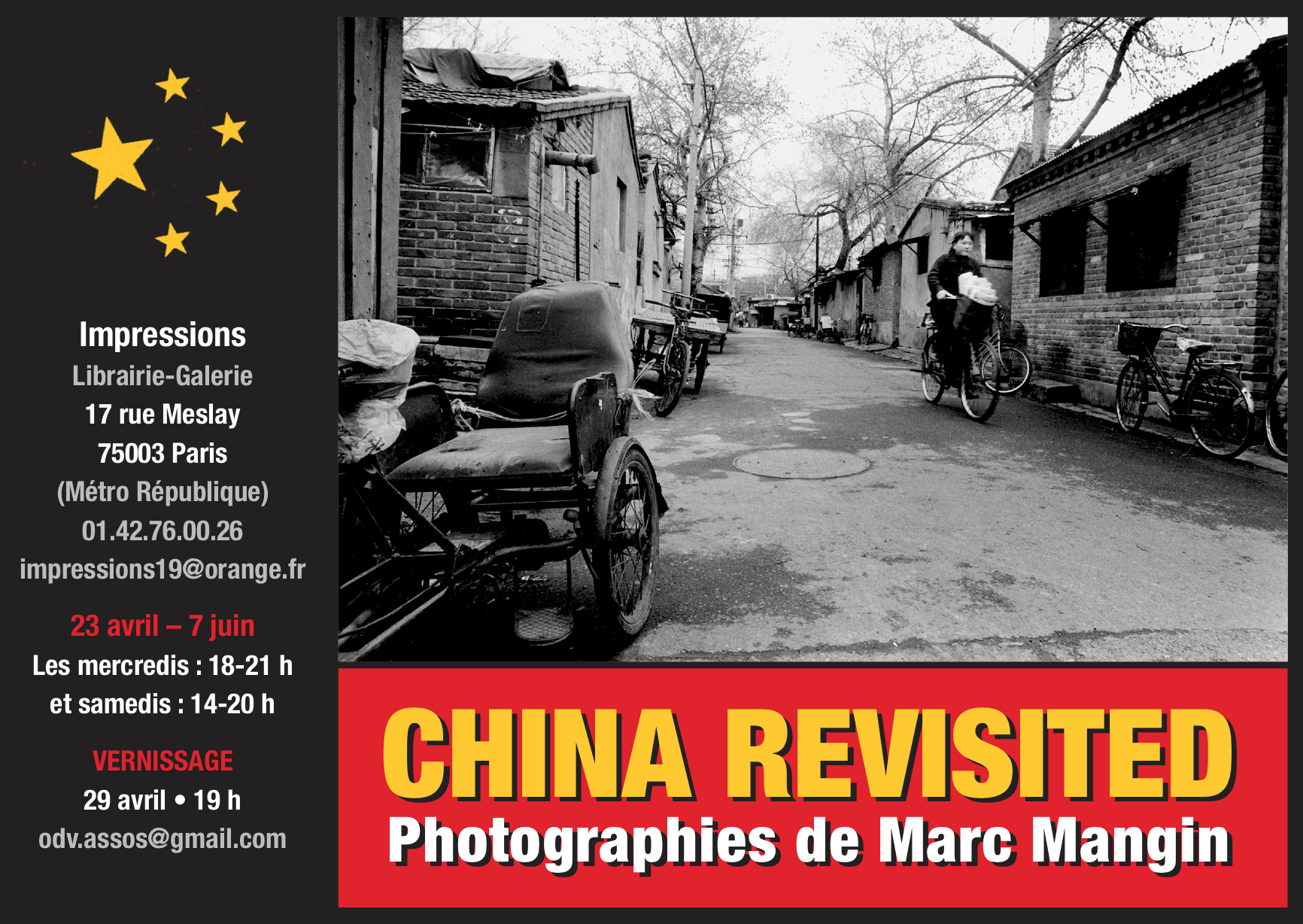David Chapelle, journaliste, responsable de la rubrique Loisirs & Culture à La Dépêche, l’hebdomadaire d’Evreux (Normandie, Eure). Il a rencontré Francis Apesteguy lorsqu’il habitait à Ezy-sur-Eure, le soir du 5 décembre 2017, jour de la mort de Johnny. Ils se sont revus de nombreuses fois, et avaient ensemble un projet de livre racontant la vie d’Apesteguy. Mais, jusqu’ici, hélas, aucun éditeur n’a donné suite à cet intéressant projet. David Chapelle a publié deux longs articles passionnants et a généreusement autorisé A l’Oeil à les publier. Cette semaine le 1er épisode.
Apesteguy, paparazzi « parce que c’était marrant ! »
par David Chapelle
Il a réalisé d’innombrables scoops, couvertures de journaux, de magazines. Il a immortalisé les plus grands, de la Callas à Jackie Kennedy, de Bardot à Romy Schneider, en passant par Mitterrand, Warhol, Jagger ou le Dalaï-Lama. Rangé des traques, des planques et autres filatures, le photographe Francis Apesteguy vit aujourd’hui à Ezy-sur-Eure (ndlr: Il a déménagé en 2020). Celui qui s’est fait un nom parmi les paparazzi les plus réputés et redoutés a accepté de nous retracer son parcours, de son tout premier scoop à sa relation pour le moins détonante avec Catherine Deneuve. Il parle avec beaucoup de franchise de son métier et des raisons qui l’ont poussé à s’en éloigner, sans jamais cesser de faire de la photographie. Rencontre en deux temps. Première partie.
Paparazzi. S’il y a un mot qui ne laisse personne indifférent, c’est bien celui-ci. Cette activité qui consiste à prendre des photos sans y être convié et les rendre publiques, est concomitante à l’avènement de la société du spectacle, ses stars couchées sur papier glacé. Un peu avant, même.
Le tout premier acte, quand Willy Wilcke immortalise Bismarck sur son lit de mort, en 1898. Le deuxième acte, en 1960, quand Federico Fellini invente le terme paparazzi, d’une contraction de pappataci (petit moustique) et regazzi (jeunes garçons).
Troisième acte, le 31 août 1997. Traquée par les photographes, Lady Di trouve la mort dans l’accident de sa voiture dans un tunnel sous la place de l’Alma, à Paris. Depuis, les paparazzi, accusés (ndlr: à tord) d’avoir précipité la fin de Diana, ont mauvaise presse – c’est le moins qu’on puisse écrire. Des rats pour beaucoup. Le mauvais œil qui favorise nos plus bas instincts – ici, celui qui nous fait tous ralentir lorsqu’il y a une voiture détruite sur le bord de la route, un corps déchiqueté au milieu des pompiers, des lumières bleutées des gyrophares, l’instinct du voyeur. Des artistes, enfin, pour ceux qui refusent de hurler avec la meute. Le temps aidant, leurs photos, à l’esthétique si particulière, ont pris une valeur de documents. En 2014, ils ont même fait leur entrée au musée, le Centre Pompidou-Metz présentait son exposition « Paparazzi ! Photographes, stars et artistes ».
« Derrière ce que l’on voit »
Parmi les professionnels consacrés : Pascal Rostain, Daniel Angeli, Ron Galella, Sébastien Valiela ou encore celui qui va nous intéresser, Francis Apesteguy. Des noms quasiment inconnus du grand public, celui-là même qui s’arrache les magazines et les journaux dont les photos, en couvertures, sont les produits d’appel. Des photos si singulières, qu’elles soient frivoles ou effroyables, intolérables ou drôles, sexy ou sordides, elles disent toujours une vérité qu’on aurait voulu laisser dans l’ombre.
« Derrière ce que l’on voit, il y a toujours ce que l’on ne voit pas, observe Francis Apesteguy, suivant le précepte de son maître d’aïkido. Eh ben, le paparazzo, c’est ça qu’il va chercher. Ce que l’on ne voit pas ».
Rangé des voitures, le « chacal », comme il se surnommait à la belle époque « pour rire, on nous appelait surtout « les rats », Francis Apesteguy a quitté Paris pour Ezy-sur-Eure, il y a 3 ans – « une envie de campagne, de maison ».
L’un comme l’autre, nous l’ignorions encore au moment de nous rencontrer, mais Johnny Hallyday allait tomber dans quelques heures sur le sol de son bureau transformé en chambre d’hôpital, dans sa maison de Marne-la-Coquette, lever les yeux au ciel et s’éteindre, selon le témoignage de Laeticia, rapporté par le journaliste Philippe Labro. C’était le mardi 5 décembre 2017.
Francis Apesteguy habite une maison à étages de 1900, non loin de la mairie de cette petite bourgade de l’Eure, réputée pour son Musée du Peigne. « Je connaissais la Normandie, Deauville, Cabourg ». Ezy, c’était pour se rapprocher d’amis. « On voulait être à un endroit où on connaissait des gens ». La maison, il l’a trouvée sur Google. « Pas à la première, deuxième ou troisième page. D’ordinaire, vous ne dépassez pas la quatrième page. Bien énervé, comme quoi ça a du bon d’être énervé, je l’ai trouvée à la treizième. Elle venait d’être mise en ligne. J’ai vu des images. J’ai vu que ça pouvait me plaire ». L’intérieur est moderne, lumineux. De grandes baies vitrées donnent sur un bout de terrain.
« Le rat des villes a essayé de faire le rat des champs avec le potager, je me suis complètement raté. J’ai mis des graines alors qu’il faut mettre des pousses – je ne le savais pas. C’est comme un sapin de Noël, nous, on le replante. Et puis on s’étonne qu’il ne pousse pas. Ça, c’est le rat des villes. Bon, ben, il apprend. » On est très loin du tourbillon de Paris. « Cette quiétude est… sombre parfois dans le pff… Pas dans l’ennui, mais… Il y a peu de travail pour un photographe, ici. je peigne un peu la girafe. C’est un peu comme un pianiste, vous lui retirez ses partitions, il va faire la gueule ».
« Mon père a été photographe – je l’ai appris, il y a 10 ans, confie-t-il, dans l’intimité de son bureau, sous le toit, au dernier étage. Il m’a dit ça, comme ça. Il en a 90, aujourd’hui. Il m’a dit : « Ah, ben, moi aussi, j’ai été photographe ». C’est bien, au bout de 80 ans, de me raconter des trucs pareils. Alors, t’as fait quoi ? « Je me souviens, j’ai photographié Brigitte Bardot en Père Noël, ça a fait la couverture de Jours de France ». Et tu les as ces photos ? « Ah, ben, non, je ne sais pas où elles sont ». Évidemment, Brigitte Bardot avait 16 ans. Et il met 80 ans à me raconter ça ».
L’atavisme. Francis Apesteguy est né en 1952, d’une famille d’artistes. Son père a été surtout un des assistants de Renoir, au cinéma, avant de devenir galeriste. « J’ai vécu au milieu des peintures et des sculptures. Après, comment j’ai fait le photographe ?», devance-t-il la question. « Pour faire simple, comme j’étais cancre, mes parents n’ont pas insisté. J’étais renvoyé tous les ans. Ou parce que je ne travaillais pas ou parce que j’imitais mes professeurs – parce que je suis un bon imitateur. C’est un don, on l’a ou on ne l’a pas. Au bout d’un moment, ils m’ont sorti de là. Et on m’a mis dans la vie active en tant qu’assistant photographe ». Un petit peu Willy Rizzo, un petit peu Sam Lévin, beaucoup Helmut Newton. « Il travaillait énormément avec la lumière naturelle, ce qui m’a beaucoup appris. Il n’y avait pratiquement pas de flash. La lumière naturelle a un beau modelé. Plus qu’avec le flash qui est assez clinique – je vous parle de lumière. Là, comme on était souvent en vitesse lente – il n’y avait pas encore le digital -, on était à 400 ou 800 ASA maximum, il y avait un déclencheur souple. Il disait : Ok et je déclenchais, Ok et je déclenchais, etc. Au bout d’un moment, ça me saoulait, il me disait : Ok puis je ne déclenchais pas (rire). Il me hurlait dessus ».
« La technique de base de la photo, soit on la comprend tout de suite soit il faut l’apprendre. Moi, je l’ai comprise tout de suite. C’est relativement simple. Il y a une ouverture qui est le diaphragme – ça passe de : 2, 2.8, 4, 5.6 jusqu’à 22, parfois 32. Et puis la vitesse. C’est la composition des deux qui fait que votre film est imprégné. Après, comment j’ai été photographe ?», anticipe-t-il encore la question. « J’en avais assez de ce monde qui était assez factice. La mode, la publicité. Je voulais faire du reportage. À l’époque, c’était dans les années 70, il y avait des événements en Irlande du Nord. À Belfast, ils se tiraient dessus, il y avait des bombes. J’avais un appareil photo, mais pas d’argent – parce que pour voyager, il faut de l’argent. J’ai tapé dix sacs à tous mes copains et copines, j’ai pris l’avion, je suis arrivé là-bas. « Il tombe sur un journaliste de l’AFP – « un gars qui avait de la bouteille, qui avait 20 ans de plus que moi ». Boni de Torhout. « Il a vu un godelureau – de même pas 20 ans – qui s’aventurait dans le journalisme. Eh bien, il m’a aidé ».
Il effectuera des rondes avec l’armée et obtiendra un rendez- vous avec l’IRA. « J’ai fait poser les mecs avec des fusils, etc. Bon, mes photos n’ont pas fait un tabac parce que je n’avais pas le talent de ceux qui étaient passés avant moi. [Raymond] Depardon avait fait des photos remarquables. [Jean-Claude] Francolon, Abbas, bien d’autres. Moi, j’étais débutant. Je faisais des bonnes images, mais pas renversantes. Mais c’était la première marche de l’escalier ». Il les donnera à l’agence Sipa, contre « un billet de deux cents balles ».
« Comme un cuisinier »
S’ensuit une première commande, la construction du Parc de Princes qu’il réalisera au fisheye – « Un œil de poisson, comme le stade est rond, ça s’adaptait bien à sa rondeur. Et ça a fait une pleine page dans le journal La Vie. Ça, ça a été payé cher. Là, on a vu que j’avais un certain talent ».
Comme la technique, l’art de la composition lui est venu de manière tout aussi naturelle, assure-t-il. « C’est un peu comme un cuisinier, quand il fait une entrecôte. Pour la faire saignante, il est l’entrecôte. Moi, quand je fais une entrecôte – que j’aime saignante -, je me ressens être dans l’entrecôte. Et je la retire à temps. Et c’est toujours parfait. Eh bien, c’est un peu ça. Ensuite est venue cette fameuse photo du Drugstore Publicis (ndlr: le 28 septembre 1972) », annonce-t-il. Où la chance n’a rien à voir, prévient-il, aussitôt. « Pour moi, la chance n’existe pas. Ce sont des fantasmes du cerveau humain qui invente des mots, comme le destin, le hasard, etc. Alors que tout n’est peut-être pas programmé, mais – pour moi – c’est plutôt atomique. Ça vient des atomes. Qui se réunissent par derrière. J’ai fait le tour et il y avait cette femme qui était accrochée à une fenêtre.
Il y avait un attroupement de gens qui lui tendaient les bras et criaient : Sautez ! Moi, je regarde le compteur de mon appareil – à l’époque, on avait 36 vues. J’étais à 35. Je ne lui ai pas dit : Ne sautez pas, mais très vite je me suis réfugié à la sortie du cinéma d’à côté, où il y avait de la lumière parce que tout était noir à cause de l’incendie. J’ai commencé à rembobiner, sauf qu’il y avait aussi le feu dans le cinéma. Je me suis fait piétiner par les gens qui courraient pendant que je changeais mon film. J’ai réussi quand même. J’ai passé deux ou trois vues, je suis arrivé, elle a sauté, j’ai appuyé, voilà. Ça a été mon premier scoop. France Soir bouclait à minuit, il devait être 23 h 15. Je fonce là-bas. Ils développent. Génial. Etc. Après, ça a fait Paris Match, d’autres parutions. J’avais donné ça à l’agence Sipa. Dans le milieu, on a commencé à me découvrir. C’est là où on a commencé à connaître mon nom ». Il y aura d’autres images, d’autres scoops, durant 40 ans. « Mais celle-là, c’est la première ».
« Ce genre de photo est relié à l’argent »
Francis Apesteguy n’était pas encore entré dans le monde du paparazzi. « Si votre prochaine question, c’est comment j’y suis entré, je peux vous raconter », devance-t-il encore. « Je faisais de l’actualité. Je photographiais la bobine des hommes politiques. Ou s’il y avait des faits divers. J’entends sur RTL que l’ambassadeur bolivien s’est fait flinguer sous le pont de Bir-Hakeim. J’y vais en trombe avec ma moto. Les flics étaient là, écartaient tout le monde. Le macchabée était dans le panier à salade. La fenêtre avant était ouverte, je passe mon appareil. Plang, plang, plang ! À coup de pied dans le cul, je suis viré de là. Mais j’avais la photo. C’était glorieux à l’époque, France-Soir. Encore la une. Des parutions partout. Et on commençait à dire dans le milieu : Apesteguy, faut faire attention à lui. Je commençais à aiguiser quelques jalousies. Plus tard, les patrons de la concurrence diront : « Apesteguy, c’est le meilleur !» Peut-être pour énerver et réveiller leurs troupes (rire) ».
« Comment je suis devenu paparazzi ? Un soir, dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, il y a cette boîte, Castel. Et je vois trois photographes sur le petit trottoir d’en face avec leurs appareils photo posés par terre. Ils sont là, ils ne bougent pas. Je vois ça, je me dis : Qu’est-ce qu’ils font ? Des photographes qui ne bougent pas. Je les interroge. Je leur dis que j’essaie de devenir photographe. Je me souviens, il y avait Jean-Paul Doucet, entre autres. Ils me disent : On est des paparazzi, paparazzo au singulier. On attend que Mireille Darc sorte. On va la photographier avec Delon. Il y aura peut-être Curd Jürgens. À l’époque, c’était bon enfant. Les gars arrivaient à savoir qui était dedans. Même qu’on pouvait rentrer chez Régine. On faisait des photos et on nous disait : Ça suffit, hop, partez ! On allait à l’Alcazar. Carte de presse ou pas carte de presse. On était une dizaine sur Paris, au maximum. »
Les paparazzi l’invitent à les rejoindre le lendemain avenue Georges-Mandel, sous les fenêtres de Catherine Deneuve. « Elle était enceinte. J’y vais. On attend longtemps ? – Tu verras bien. Parfois, c’est long. Là, elle habite au dernier. Au premier étage, il y a Maria Callas. Ça aussi, ça vaut du pognon. Ce genre de photo est relié à l’argent. Forcément. Une des grandes motivations de la photo de paparazzi, c’est l’argent que ça rapporte », observe-t-il. Même si à cet instant, il ne le sait pas. « Je vais le découvrir. Et avoir la même motivation, finalement. Parce que c’est bon, quand même, quand ça roule… »
Et, c’est aussi « une bonne école. Comme on n’est pas invité, c’est vite et bien », son credo, sa marque de fabrique. « On n’a pas le choix. À l’époque, on n’avait pas Photoshop, c’était ou bon ou mauvais. Et si c’était mauvais, c’était la poubelle. Si c’était bon, c’était au kiosque. »
Il se lance dans l’aventure, non pas pour l’argent, mais « parce que c’était marrant. Cavaler après Deneuve qui court comme une gazelle ou photographier la Callas qui est sympa ; ou Jackie Kennedy qui se cache aussi, ou Romy Schneider qui se cache tout en rigolant. Il y a un jeu, c’est vachement marrant. Et puis, il y a ce jeu vis-à-vis de soi- même, d’être bon, vite et bien. J’ai fait ma première couverture de Paris Match avec Madame [Yvonne] de Gaulle, quand elle était veuve. On était trois à avoir l’information, comme quoi elle vivait dans une maison de retraite à Paris. J’ai fait un portrait en évitant les coups de parapluie avec mon petit 85 mm. Je peux vous dire : faut être bon. Et c’est vachement intéressant d’être bon. On apprend à être bon en étant mauvais. J’en ai raté. »
« Laisse, il a faim ! »
Comme « ce soir où il n’y a pas eu de photo ». [Jean-Paul] Belmondo sortait de La Coupole. « Avec quatre copains de chaque côté. C’était vraiment l’image des Douze salopards. Ils tenaient tout le trottoir en ligne. J’étais caché, je me montre pour faire une photo et, là, il y a un de ses potes qui s’avance pour m’attraper. Je n’ai pas encore appuyé – parce que je vois qu’on veut m’attraper ou me boxer. (ndlr: écouter le récit d’Apesteguy en podcast)
Au moment où il m’attrape, je ne peux toujours pas faire de photo. Il y a Belmondo qui dit : « Laisse, il a faim ». (rire) Et moi, je me suis carapaté. Il n’y a pas eu de photo et pour cause. » On revient avenue Georges-Mandel pour Catherine Deneuve. « Elle était enceinte de [Marcello] Mastroianni. À l’époque, les ventes en Italie étaient très rémunératrices, c’était la traque principale du moment. Je suis arrivé trop tard pour la faire à la sortie de la clinique. Je n’avais même pas l’adresse. Je débutais, je ne savais pas. Les autres avaient enquêté. C’était la clinique Spontini, dans le XVIe. Il y en a deux ou trois qui ont la photo d’elle en train de courir avec son bébé dans les bras. Moi, je n’ai rien raté parce que je n’y étais même pas. » Il aura l’occasion de la croiser plus d’une fois, on le verra.
Outre son credo du « vite et bien », Francis Apesteguy opte pour la technique de l’attaque frontale plutôt que d’utiliser le zoom à distance. « À l’époque, on était obligé d’être vu. Il n’y avait pas la sensibilité des appareils photo digital d’aujourd’hui. C’était du 400 ASA, point ! On pouvait pousser à 800, mais on commençait à avoir du grain. Au-delà, c’était de la neige. Donc, j’allais au contact. Pas toujours, parfois, il fallait utiliser le téléobjectif. » Dans tous les cas, «il fallait être malin. Comme pour le baron Empain. Je me souviens de cette fameuse histoire. J’arrive à Marrakech en retard. Les autres n’avaient pas réussi, ils s’étaient fait virer de l’hôtel par la sécurité.
« C’était à La Mamounia. Empain avait été libéré, il était allé à l’hôpital. Sa femme l’avait quitté. Lui, il avait une maîtresse. J’ai le renseignement plus tard par Paris Match et VSD. Je pars deux jours après. Je les croise à l’aéroport. Ils me disent : « C’est même pas la peine d’essayer ». Dans l’avion, je m’étais fait copain avec un couple de Belges. Je les invite à boire un verre à La Mamounia, au bord de la piscine. J’avais juste un boîtier et une optique 80/200 mm ; à la douane, on m’avait confisqué mon deuxième boîtier et trois objectifs. On se retrouve à La Mamounia. Il y a des gens qui batifolent dans la piscine. Et un gros service d’ordre, 10 ou 12 types en costume. Moi, je ne cache pas mon appareil. Je viens avec mes deux touristes. Je pose l’appareil sur la table, bien visible. Grand innocent. On prend notre thé. J’avais un Nikon, dont le chapeau du dessus s’enlevait. On voyait le verre dépoli. On pouvait cadrer. Tout d’un coup, mon cœur se met à battre. Il y a de l’adrénaline, dans ce job. Le baron Empain arrive avec sa gonzesse en maillot de bain. Je cadre, je règle l’appareil. Je prends une petite gorgée de thé. J’appuie une fois. Je remonte le film. J’appuie une deuxième fois. Tac ! Au moment du bisou. Je reprends un peu de thé. Quelques friandises. Je remonte le film, etc. Cinq ou six photos, pas plus. »
« Quatre pages dans Match. Et j’en ai fait des coups comme ça, j’en ai fait. C’est tellement marrant. »
( La suite dans notre édition du vendredi 11 février 2022 )
Voir le site officiel de Francis Apesteguy
Ses archives chez Hans Lucas
Tous nos articles concernant Francis Apesteguy
Dernière révision le 8 octobre 2024 à 6:42 pm GMT+0100 par
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi




 Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ?