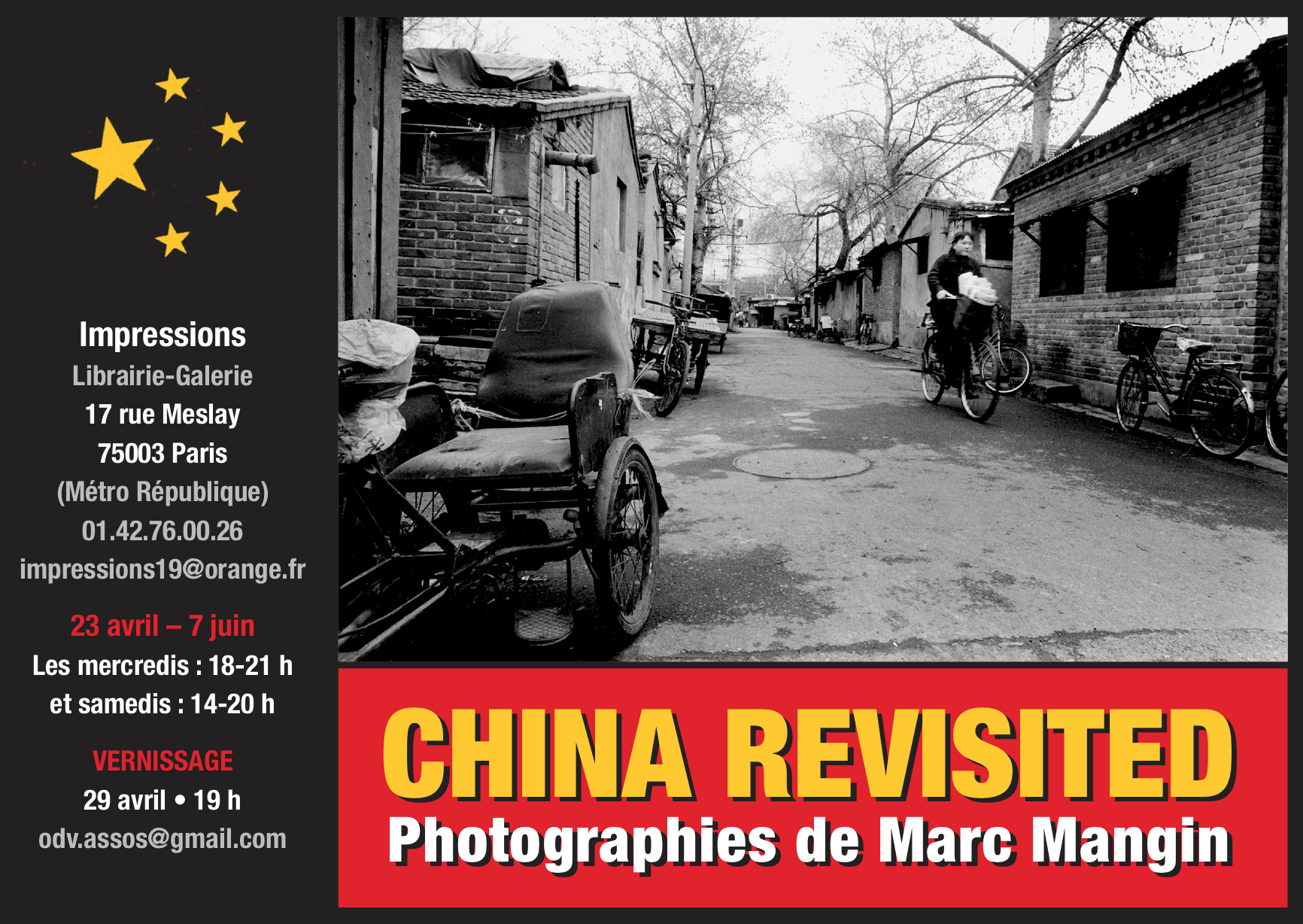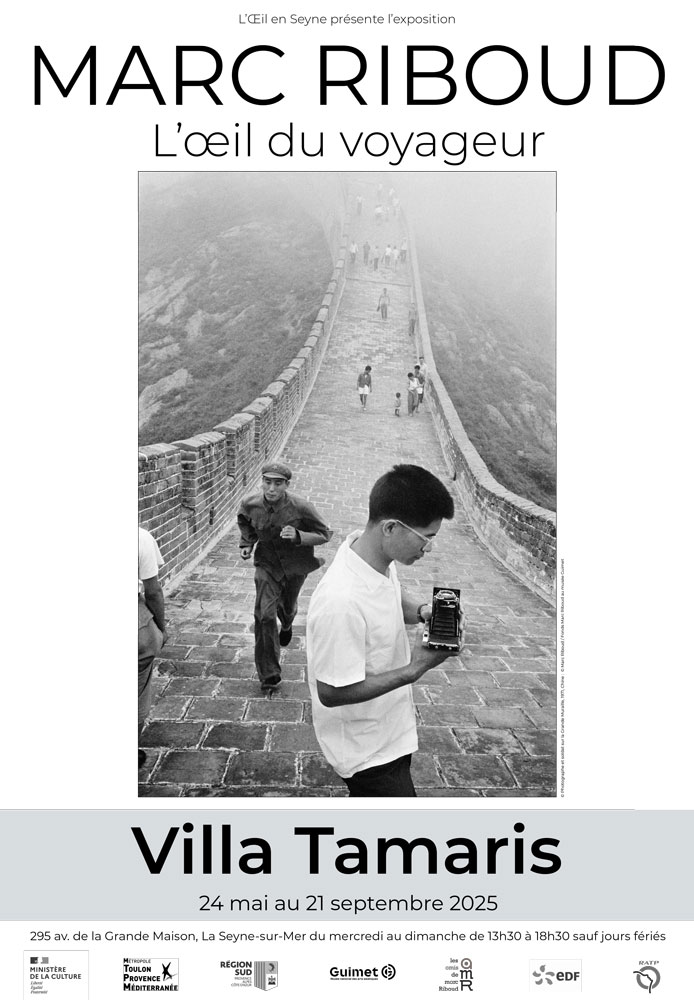David Chapelle, journaliste, responsable de la rubrique Loisirs & Culture à La Dépêche, l’hebdomadaire d’Evreux (Normandie, Eure). Il a rencontré Francis Apesteguy lorsqu’il habitait à Ezy-sur-Eure, le soir du 5 décembre 2017, jour de la mort de Johnny. Ils se sont revus de nombreuses fois, et avaient ensemble un projet de livre racontant la vie d’Apesteguy. Mais, jusqu’ici, hélas, aucun éditeur n’a donné suite à cet intéressant projet. David Chapelle a publié deux longs articles passionnants et a généreusement autorisé A l’Oeil à les publier Cette semaine le 2ème épisode. (Lire la 1ère partie)
Francis Apesteguy: « Ce que je faisais était frivole et abêtissant »
par David Chapelle
Il a réalisé d’innombrables scoops, couvertures de journaux, de magazines. Il a immortalisé les plus grands, de la Callas à Jackie Kennedy, de Bardot à Romy Schneider, en passant par Mitterrand, Warhol, Jagger ou le Dalaï-Lama. Rangé des traques, des planques et autres filatures, le photographe Francis Apesteguy vit aujourd’hui à Ezy-sur-Eure (ndlr: il a déménagé à Orgeval en 2020). Celui qui s’est fait un nom parmi les paparazzi les plus réputés et redoutés a accepté de nous retracer son parcours, de son tout premier scoop à sa relation pour le moins détonante avec Catherine Deneuve. Il parle avec beaucoup de franchise de son métier et des raisons qui l’ont poussé à s’en éloigner, sans jamais cesser de faire de la photographie. Rencontre. Seconde partie.
Très vite, Francis Apesteguy s’est fait un nom dans le milieu des paparazzi. Plus encore quand on va le découvrir en personnage clé du film de Raymond Depardon, Reporters (1981). « Je ne suis pas connu comme Richard Gere », relativise-t-il. Et de toute façon, il n’avait d’autre choix que d’avancer à visage découvert.
« On ne se cache pas. On est au contact. Ou on ne veut pas de nous et on nous fout des coups de pied, des coups de poing, et on se débrouille avec ça [en témoigne la scène immortalisée par le photographe Daniel Angeli où Francis Apesteguy prend un coup de sac de Marlene Dietrich, à l’aéroport d’Orly, en 1975.
À l’époque, je faisais de la boxe. Je savais me protéger des coups de Deneuve, parce qu’elle en donnait – moi, je ne les rendais pas. Gentleman paparazzo ! (rire). C’était la plus coriace, une vraie fauve. » Deneuve, il évoque cette histoire incroyable dans le livre « La Gloire, c’est du boulot », de Franck Leclerc (aux Éditions Pygmalion). Il la détaille, ici.
« Elle arrivait chez elle en voiture, dans son Austin. Je faisais des photos – elles n’avaient aucun intérêt, c’était faire des photos pour faire des photos. Je me faisais plaisir. Comme d’habitude, elle m’a sauté dessus. Il lui est même arrivé de rentrer dans ma voiture, de prendre l’appareil qui était sur le siège passager et le balancer dans la rue. Elle faisait ça. Comme une tigresse. On a fait des poursuites de nuit dans Paris. Elle grillait tous les feux rouges, moi aussi. On était complètement cinglés ».
Sur le marché d’Ezy-sur-Eure

« Je me souviens d’un détail. Elle avait une robe avec des boutons. C’est haut, la marche pour monter dans le panier à salade. Tac, elle pète un bouton. Je le ramasse et le lui rends (rire) sans un mot de sa part. » On les conduit au commissariat du XVIe.
« On ne nous a pas mis en cage. Là, elle a tout de suite été reçue par le commissaire pendant 20 minutes. Moi ensuite. Le commissaire m’a sermonné. Il m’a dit : C’est pas bien. Vous embêtez les gens, Madame Deneuve, une grande artiste, enfin tout le violon qu’on peut connaître. Je n’ai pas été en garde à vue, non plus ».
Ce souvenir prend un tour encore plus savoureux, voire croquignolesque, lorsqu’on apprend que les deux protagonistes se retrouvent régulièrement sur le marché d’Ezy-sur- Eure, son bistrot. « On est là, l’un à côté de l’autre. Et on joue aux gens qui ne se connaissent pas » (rire). Il ne lui a jamais parlé. « Elle m’a parlé un jour, elle m’a demandé si elle pouvait prendre la chaise qui était libre à côté de moi, alors qu’il y en avait bien d’autres. Je pense qu’elle a fait une tentative. Je ne sais pas ce qui m’en empêche. J’attends peut-être l’occasion. Ça se fera un jour, juge-t-il. On va se retrouver dans un dîner. Il y aura une connaissance commune. Vincent Lindon qui était sorti avec sa fille Chiara. Ils sont séparés, maintenant. Mais j’ai un copain qui m’a dit qu’il avait vu Vincent Lindon au bistrot avec Deneuve. Peut-être que Vincent viendra un jour, je suis pote avec lui, et il lui dira : Francis, tu le connais ? Et voilà. Elle dira : Ben, oui, il doit avoir des souvenirs aussi. » On dit que Catherine Deneuve aurait quitté la région. « On m’a dit qu’elle avait vendu son château ». Il s’interrompt un instant.
« Dimanche dernier, je ne l’ai pas vue. Mais je l’ai vue le dimanche d’avant. Elle va au bistrot qui fait le coin, il y a une terrasse où il y a du soleil. Elle, elle boit un café, moi du vin blanc, voilà » (rire). On s’étonne, au passage, de son amitié avec Vincent Lindon. Pas le comédien le plus amène à l’égard des paparazzi. Bien au contraire. Ce que nous confirme Francis Apesteguy. « À l’époque, il était avec Caroline de Monaco. Et moi, je faisais beaucoup de photos officielles, pas en tant que paparazzi que j’avais arrêté depuis un bout de temps ». A Orly, le comédien lui tape sur l’épaule, lui donne du « Salut Francis », le tutoie d’emblée alors qu’ils ne se connaissent pas. « Je ne l’avais jamais vu ou photographié ». Vincent Lindon l’informe qu’on le cherche partout, on « c’est Caroline et lui ». Il lui demande comment sortir du piège des paparazzi. « On n’en peut plus. Il y a toujours quinze mecs en bas de la maison. Et tout le monde essaie de nous photographier ensemble. Toi qui ne fais plus ça, comment on peut faire ? Tu peux peut-être nous conseiller pour nous en débarrasser ». Francis Apesteguy avait sa petite idée.
« Je lui ai dit : Écoute, tu sors avec Caroline, bras dessus, bras dessous. T’as le Champ-de-Mars, à côté. Il y a quinze mecs qui vont vous suivre. Ils vont vous shooter. Tu t’assois sur un banc. Et vous vous bécotez. Trois minutes, pas plus. Tu l’enlaces, et vous rentrez chez vous. Le lendemain…
– Oui, mais attend !
– Non, non, tu m’écoutes. Tu me demandes, je te réponds. Le lendemain, avec les mêmes habits, tu fais exactement le même truc, avec le même timing. Là, au lieu d’être quinze, ils seront 50. Le surlendemain, à la même heure, avec les mêmes vêtements, tu fais le même chemin, les mêmes gestes, les mêmes bécotages. Tu verras, ils seront 50, 60… Vous rentrez chez vous. Quatrième jour. Vous sortez, il n’y a plus personne. Pourquoi ? parce que vous ne valez plus un clou. Tu auras tari la source. Le marché sera inondé. On ne voudra plus de photos de vous. On les aura achetées très cher le premier jour. Beaucoup moins cher le deuxième. Le troisième, ils ne les auront pas vendues. Le quatrième, non plus. Le cinquième, il n’y aura plus personne. Tu pourras changer de tenue.
– Mais je vais être complice !
– C’est la seule façon. Tu taris la source », tranche le paparazzo repenti. Plus tard, quand Vincent Lindon fera le film d’Alain Berberian, Paparazzi (1998), Francis Apesteguy sera engagé comme conseiller auprès du comédien pour lui enseigner les gestes, les cachettes, comment photographier avec un téléobjectif tout en se cachant, comment être dans la confusion des éléments, ne pas être habillé en jaune ou en rouge, évidemment ; bref le b.a.ba du métier. « Il faut que vous appreniez ça à Vincent Lindon, parce que lui le subit, mais il ne sait pas le faire », lui avait expliqué le réalisateur. « Donc, j’ai été son conseiller et je me suis bien marré ». Il livre, au passage, l’état d’esprit dans lequel il faut être pour être un bon paparazzo, en citant Cartier-Bresson. « Il disait : Je fais le trottoir. En faisant le trottoir, le pas est lent, on a un regard panoramique. Parfois, on devine même ce qui va se passer. Il disait : Il ne faut rien vouloir, sinon on n’a rien. C’est très philosophique. Ça s’apprend avec l’expérience du temps. Tout est philosophique ».
Et puis, il a arrêté. « Ce que je faisais était frivole et abêtissant. Eh bien je suis passé à des choses plus sérieuses – qui se sont révélées plus enrichissantes. À l’époque, à l’agence Gamma, il y avait plein de possibilités. Il y avait un service qui faisait du news, de la politique, du showbiz, du grand reportage ». Le service showbiz lui proposera de faire des photos en studio. « C’est intéressant de faire poser les gens. C’est même très fatigant, on donne tellement d’énergie. Mais c’est passionnant. J’ai fait des politiques, des artistes. C’est comme ça que j’ai évolué.
« Dans la maison du Dalaï-Lama »

Ensuite, je me suis orienté vers le grand reportage. Là, on ne fait pas qu’un constat, on raconte une histoire. Je suis parti six semaines, par exemple, pas derrière Deneuve, pas derrière Onassis, pas derrière Travolta, pour décrire, raconter et parler des Tibétains, de leur exil – parce qu’on voit des choses fausses en Occident, on ne voit que des livres avec des chapeaux dorés et des trompettes en argent. Parce que l’exil, c’est terrible à vivre. Alors, il y a des moines qui ont préservé quelques bidules dans leurs monastères, c’est toujours beau, mais ce n’est pas ça l’exil. J’ai été jusqu’à avoir un rendez- vous dans la maison du Dalaï-Lama, que j’ai photographié. J’ai été dans les temples, mais aussi dans les bidonvilles. J’ai vu des enfants qui avaient traversé l’Himalaya en baskets. Il fallait leur couper les orteils. Leur couper les orteils ! J’ai raconté tout ça, ça a fait dix pages dans le Figaro Magazine ». N’allez pas lui dire que le photographe se cache derrière son appareil photo. « Ceux qui disent ça, le disent mal. Ce n’est pas ça qui protège. Parce que j’ai photographié des gens morts lors du tremblement de terre à Bucarest, par exemple. On n’est pas protégé par un appareil photo, on l’est par l’amour de ce qu’on fait, le cadrage, la composition. Tout ça peut flinguer une image si c’est mauvais. Alors qu’une image, elle parle, c’est comme un son, une musique, un trait de pinceau. Ça parle. Mais ça peut aussi ne pas parler. Donc, l’important c’est de la faire parler. On est tellement occupé à ça qu’on est vraiment insensible au reste, à la douleur des autres parce qu’on a notre propre douleur à assumer. C’est- à-dire : trouver le bon cadrage. Même si on l’a d’instinct. On est dans ce tuyau. C’est le travail intellectuel qui se développe. La photographie se fait en trois étapes : la plus importante, c’est là, dans la tête. Vous avez déjà photographié dans votre tête. Je sais ce que je vais faire. Ensuite c’est de la technique, l’ouverture, la vitesse, on déclenche. Après, c’est le travail de labo ou aujourd’hui sur Photoshop, c’est rendre la photographie telle que l’œil l’a vue. Mais la plus importante, c’est là (la tête), on ne se protège pas, on fait ! »
Autre conseil. « Ne pas faire qu’un constat ». Il cite son ami [Sebastiao] Salgado. « Il dit : Je n’ai pas photographié la misère des réfugiés. Je photographie la dignité de ces gens ». C’est beau, ça. On en fait quelque chose. Parce que, quelque part, ils sont très dignes. Qu’est-ce qu’ils viennent chercher chez nous ? Ils ne viennent pas nous voler. Ils viennent chercher un peu de respect, une vie normale comme ils avaient avant. C’est tout. Ça tourne à la politique… C’est vrai », ajoute-t-il avec la voix de Mitterrand, toujours son don d’imitateur. Il ne joue plus le paparazzo, depuis. « Ah oui. » Enfin, lui revient cette anecdote, un retour de flamme. « Quand Hollande est devenu président, le temps qu’il rentre à l’Élysée, c’était intéressant de le suivre. J’avais une moto. Et il y avait des paparazzi aussi, comme c’était le sujet du moment. Je retrouvais des mecs que j’avais connus avant. Ils me disent : Viens nous voir, on fait Carla Bruni. On essaie de la faire avec son bébé, on n’y arrive pas.
À la poursuite de Carla Bruni
Je prends quand même un petit 400 mm. On sait jamais. Avec des baskets. Un blouson. J’enfourche mon cheval de feu. J’y passe deux ou trois jours. Je vois leur façon de travailler, plus performante grâce au digital. Un jour, elle s’en va, se rend dans un magasin de thé très connu à Saint-Germain-des-Prés. Des petites rues. Voiture, chauffeur, gardes du corps. On était quatre ou cinq. Elle sort de la voiture. On la photographie. Moi, comme les autres, sauf que je fais ça pour me marrer. Je ne vais pas vendre ça, je vais faire quoi avec ça ? Ça n’a aucun intérêt. Les autres shootent. Je fais pareil. Je me marre. Elle vient vers nous, commence à nous gueuler dessus.
« Vous m’emmerdez ! » Et j’avais envie de lui dire que ce n’était peut-être pas à nous qu’elle devait s’adresser, que nous, on était commandité, qu’elle devrait peut-être gueuler après les commanditaires, mais elle ne peut pas parce que ce sont ses amis, s’emporte-t-il. Ah bah oui ! Les Murdoch, en Angleterre. Bernard Arnault, ici. Lagardère, Bouygues, etc. qui possèdent la presse. Ce sont eux les commanditaires, c’est eux qu’il faut engueuler. Ce n’est pas nous. Et, au moment où j’allais lui dire ça, elle tourne le dos et s’en va. Tant pis, je lui dirai la prochaine fois ». Il la retrouve un peu après à sa voiture, suivant la règle de base du « qui vient en voiture repart en voiture », la mitraille « C’était jouissif ». Elle lui adressera un « Va fan culo ».
Forcément, on pense à la mort de Lady Di, un tournant dans l’histoire de la presse à scandale, des paparazzi. « Je venais de finir une commande pour Libération sur l’engouement autour d’une star. À l’époque, c’était Madonna. Elle était à l’hôtel Ritz. Evidemment, l’ancien paparazzo a pris le dessus. Quand elle est sortie, qui était bien placé ? Je n’ose pas dire le mieux ? C’était moi », dit-il en empruntant la voix de Michel Galabru.
« Et ensuite est cette histoire de Diana justement…. C’est intéressant. Cette histoire, moi, je n’étais pas là. C’est ma femme qui me l’a appris le lendemain. J’ai été invité sur les plateaux télé, le journal de 13 heures de TF1, etc… Je disais au mec de LCI, vous savez que vous allez vous faire virer. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement fou de m’avoir invité, moi qui vais dire du mal de votre patron. Parce que les paparazzi, c’est bien « paparazzi assassins ! », ça arrange tout le monde. Comme ça, on ne voit que ça. On ne parle que de ça, mais ce n’est pas une bande de pigeons voyageurs qui étaient en vacances qui ont suivi une voiture, les paparazzi qui étaient là. Ce sont des gens qui étaient commandités. Alors, surtout, ne parlons pas des commanditaires. Ceux que je viens de vous citer. Si la presse est pourrie, c’est eux qui la pourrissent. »
Il exonère, au passage, le lecteur. « On lui infuse ça dans le cerveau. Par relais. Il n’y a plus que ça. Vous me direz qu’il y a des lectures plus intelligentes. Mais ça a tellement amplifié, ça prend une telle place que je me permets de dire qu’il n’y a plus que ça. Quand je dis par relais, c’est quoi ?
« Paparazzi assassins !
Ca arrange tout le monde »
Parce que ces gens contrôlent les radios, les télés, les journaux. Là-dedans, ils mettent ce qu’ils veulent. Exactement la même chose dans les trois. Comment voulez-vous penser autrement quand vous n’avez que ça ? Ah ah ! C’est la faute des gens ? Je n’ai pas vu de manif à Paris, des gens avec des pancartes : on veut du Diana, on veut du Caroline de Monaco. Je n’ai vu personne manifester avec des « On veut ! » « On veut ! » On ne leur donne que ça à manger. Et, en plus, c’est une drogue pas chère, en vente libre, à 5 balles au kiosque. Quand Diana est morte, dans une interview à Libération, je disais : s’il n’y avait pas de dealers, il n’y aurait pas de drogués. C’est tout… Je suis toujours bien énervé, admet-il. C’est un peu Mélenchoniste comme réflexion parce que c’est contre le patronat, mais enfin, ils ont leur responsabilité. Il y a aussi une question d’argent, combien ils se gavent quand un paparazzi prend 20 000 balles ? Eux, il y a 4 zéros en plus. Et puis, au lieu d’avoir un 16 mètres, eh bien le yacht, on va en prendre un à 30, comme ça, il y aura la place pour l’hélicoptère ». L’argent ? « Je n’ai pas suivi l’un des conseils de mon grand-père qui me disait : Pendant les vaches grasses, pense aux vaches maigres. Financièrement, j’ai connu la marée basse », confie-t-il.
Certaines de ses photos n’ont jamais été rendues publiques. Celles qu’il nomme ses « ignominies ». « Forcément ». Il y a les « ignominies montrables », la dernière photo d’Onassis sur son lit d’hôpital, à la veille de sa mort.
« Ça a fait Paris Match ». Il y a les papiers bleus qui bloquent le processus de diffusion au risque d’une procédure judiciaire.
« Personne ne se mouille dans ces cas-là. À chaque fois qu’on se fait prendre, c’est pareil ».
« Une agence pour laquelle j’ai travaillé a dû détruire une série de photos. Parce que ça allait vraiment trop loin. C’était quelqu’un de très, très célèbre, un grand champion dans un hôpital qui s’est réveillé au moment où je le photographiais.
Ce n’était pas beau à voir. Et mes photos étaient bonnes. Là, quand les avocats se sont réveillés, ça promettait de faire très mal. On ne m’a pas rendu ces photos. Elles doivent être dans un coffre ou détruites. Dernièrement, en fouillant dans mes ignominies que je conserve, j’ai retrouvé une série que j’ai failli brûler – et que, finalement, j’ai gardée. J’étais allé voir un avocat spécialisé. Il m’a dit : vu les noms que vous me citez et les images que je vois, la façon dont vous les avez obtenues, ce n’est pas un procès qui vous attend. C’est la mafia qui va s’occuper de vous et de votre famille. Et vous n’aurez plus besoin de moi ».
« Nous faisons une photo qui tourne… »
Dès lors, je m’étonne qu’il me reçoive ainsi, qu’il m’ouvre sa porte en toute simplicité, qu’il ne vive pas caché.
« Ben, non, les ignominies, elles ne sont pas sorties. À la limite, personne ne sait que c’est moi qui les ai faites. Les victimes ignorent l’existence même de ces photos. C’est dans mes archives ».
S’il ne devait garder qu’une photo ?
« J’en ai fait tellement » Il reformule la question : « Vous êtes photographe et vous avez envie d’emmener une photographie dans votre cercueil, ce serait laquelle ? Là… On ne peut pas se défiler. C’est sans issue. Si on la pose comme ça, il n’y en a qu’une, c’est celle avec le Dalaï-Lama. Il y a un tel contraste entre les gens en prière et les gardes du corps armés, autour de lui ! J’ai réussi à faire cette photo parce que je viens de l’école du vite et bien. Parce qu’on ne l’approche pas comme ça, même si on est pote avec lui ».
Et maintenant. Il ne cultive « pas de regrets, ce serait idiot. C’était une bonne école qui apprend à travailler vite et bien. Il ne faut pas passer sa vie dedans. » Depuis, il a fait des photos de gens « natures », réalise des photos d’art. Là, il va encore vers une autre photo.
« En ce moment, je fais des photos de maisons à vendre. C’est intéressant. On rentre dans le graphisme, la géométrie, les masses qui se compensent. C’est un peu de la carte postale, c’est très strict. Parce qu’on a toujours tendance à en mettre trop dans une image. Plus on en met, moins on voit le principal. » Il évoque encore un souvenir, de ceux qu’il a consignés dans un livre qu’il souhaiterait voir publier. « Parce qu’il s’est encore passé un truc étrange. C’était le premier conseil des ministres de [Jacques] Chirac. J’avais loué cet appareil dont l’objectif tourne sur lui-même pour imprégner la pellicule. Tournant à 360 degrés, ça fait le tour d’une pièce. Je fais des essais. Paris Match voulait l’exclusivité de ce travail. Le jour J. Tous les ministres sont là. Pour ne pas apparaître sur la photo, je me cache derrière Juppé. Chirac explique à tous les ministres (il prend la voix de Chirac) : Nous faisons une photo qui tourne… Je l’interromps pour lui préciser qu’on va la faire dans 15 secondes. Et d’un coup, je me retrouve dans un vide terrible. Comme je vous disais, la photo se fait dans la tête. Comme si elle était déjà faite. Et, là, je me dis : Oh, putain ! C’est exceptionnel ce que je suis en train de faire, mais qu’est-ce que c’est nul. C’est dramatiquement nul. Parce que je vais appuyer, là, pour leur faire plaisir, qu’est-ce que je vais faire ? Un constat. Je me suis senti dans un vide, comme si je tombais dans un précipice. Je n’arrivais pas à appuyer alors que tout le monde s’impatientait. Tout d’un coup, moi je suis athée, donc ce n’est pas Dieu, Mahomet, mais c’est comme si quelqu’un me mettait un truc dans la tête – c’est mon imaginaire qui s’est mis en marche. J’ai mis mes mains en porte-voix. Je me suis tourné d’un côté et de l’autre. Je leur ai crié : Mesdames, Messieurs, ne bougez pas, vous regardez tous le Président. J’ai pensé à la Cène. Monsieur le Président, vous regardez l’appareil. J’ai appuyé. Et cette image était magnifique parce qu’elle racontait quelque chose. Sinon, c’était un constat. Et celui-ci me faisait tellement froid dans le dos que j’étais tétanisé. Mon imaginaire a vu la Cène. Sur cette photo, Chirac est comme Jésus dans la Cène. C’est comme ça qu’elle est belle, sinon elle était comme un balai. »
Autre souvenir à 360°
« J’aime beaucoup les photos panoramiques », précise-t-il. Le Sénat lui en commande une sur le modèle du conseil des ministres, de l’Assemblée nationale qui était parue en dépliant dans Paris Match. « Avec l’histoire de la photo : Apesteguy, le plus beau, celui qui marche sur l’eau, comme ils savent le faire », s’amuse-t-il. « Donc, le Sénat me commande cette photo. Et le jour J, le film ne s’est pas accroché (rire). Quand j’ai rembobiné le soir, je n’ai pas senti le clac. Et, là, vous avez et très chaud, et très froid. Vous avez envie de pleurer, mais ça ne sort pas. Mais c’est une telle humiliation. Vous avez envie d’aller vous cacher au Chili. Le pire, c’est que le lendemain matin j’avais rendez-vous avec le président du Sénat, Pierre Poncelet. J’avais tellement honte. Il n’allait pas réunir à nouveau tous les sénateurs. C’est une grande leçon, pleine d’humiliation, mais ça fait grandir. »
Au moment de nous séparer, à l’issue d’un second entretien au lendemain du décès de Johnny Hallyday, il confesse :
« Je n’ai pas la prétention d’être autre chose que ce que je suis. Je me contente de ce que je suis. Aujourd’hui, je m’apprête, trois jours après, à diffuser afin de les vendre des belles images de Johnny Hallyday. Mais j’ai mis trois jours à me décider. Parce qu’au début, ça me flanquait plus le blues que l’esprit marchand. Mais un photographe vit de ses photos. Si j’ai de belles images, c’est quand même mieux de les partager, d’en tirer quelque chose pour manger – et pas m’acheter un avion. On ne fait pas photographe pour être riche. J’ai mis trois jours. Je vais le faire. Le quatrième. C’est vrai ! rit-il, en prenant une fois encore la voix de Mitterrand. Il n’a pas dit son dernier mot. « Un photographe, c’est comme Molière, il meurt en scène. Un pianiste, parce qu’il touche sa retraite ne touche plus son piano, le peintre sa peinture ? »
« Qu’est-ce que je me suis marré »
Verdict : « Qu’est-ce que je me suis marré, mais bien sûr que je me suis marré. Foutez Brel en colère, Onassis en colère – plus les gens s’énervent, plus c’est photogénique. Même s’ils ne sont pas en colère, vous avez un tel plaisir de cadrage. De possession, peut-être même. Allez savoir ce qui se passe dans la confusion de l’esprit. Il y a peut-être une histoire de possession du sujet. Il doit y avoir ça. Roland Barthes qui me cite dans son livre [La Chambre claire, ndlr], au sujet de la photo du Drugstore, je pense qu’il parle de possession. Ou quelque chose comme ça. Ce que vous photographiez devient objet. Il y a peut-être dans l’inconscient, une appropriation. C’est ce que je ressens. Il se passe quelque chose comme ça. Puisqu’après, c’est votre photo. C’est la photo de l’autre, mais c’est vous, c’est votre photo. C’est vous qui l’avez créée. Comme un peintre, c’est sa création, sa chose. Je suis Dieu. (rire) »
David Chapelle
Voir le site officiel de Francis Apesteguy
Ses archives chez Hans Lucas
Tous nos articles concernant Francis Apesteguy
Dernière révision le 8 octobre 2024 à 6:42 pm GMT+0100 par
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi