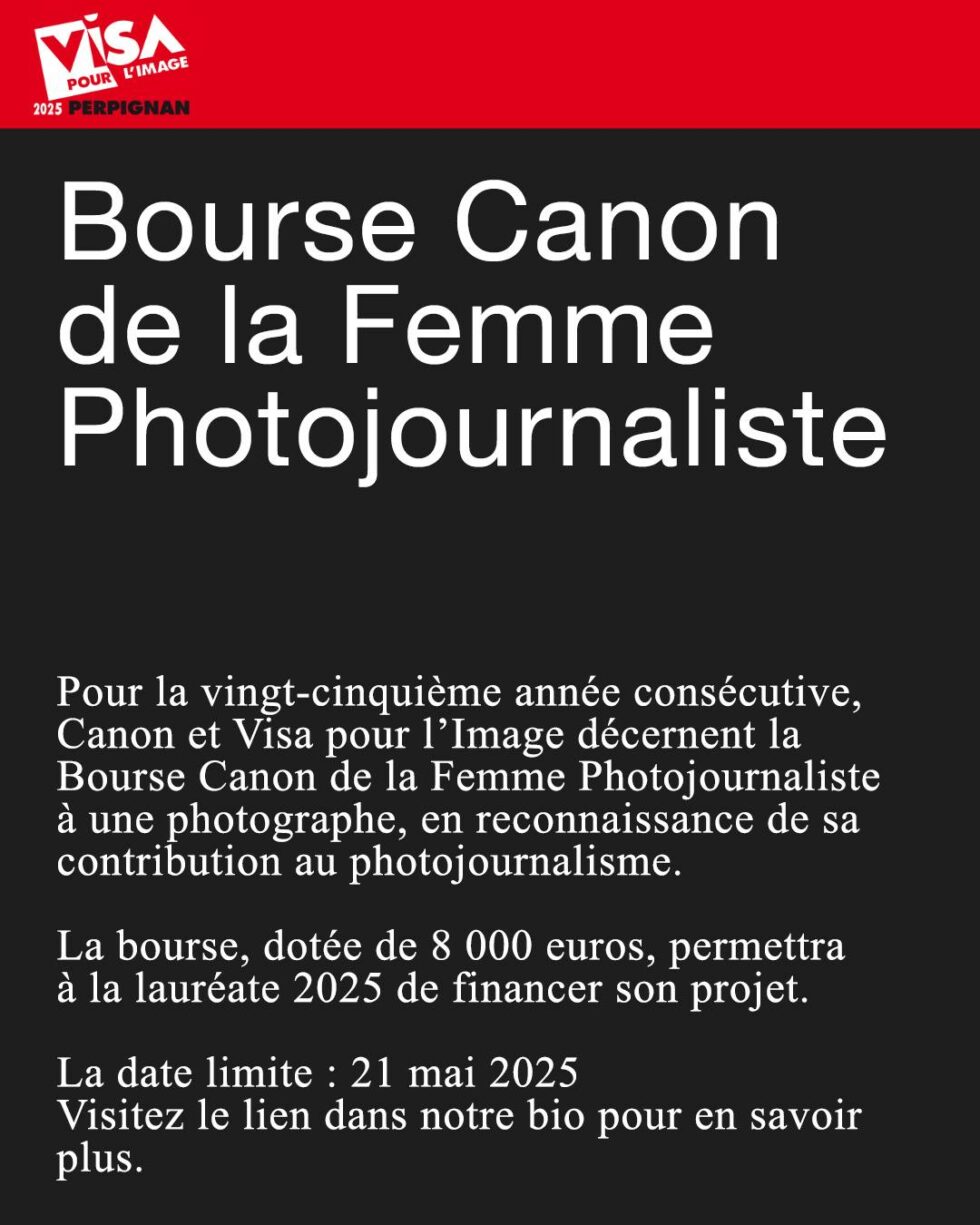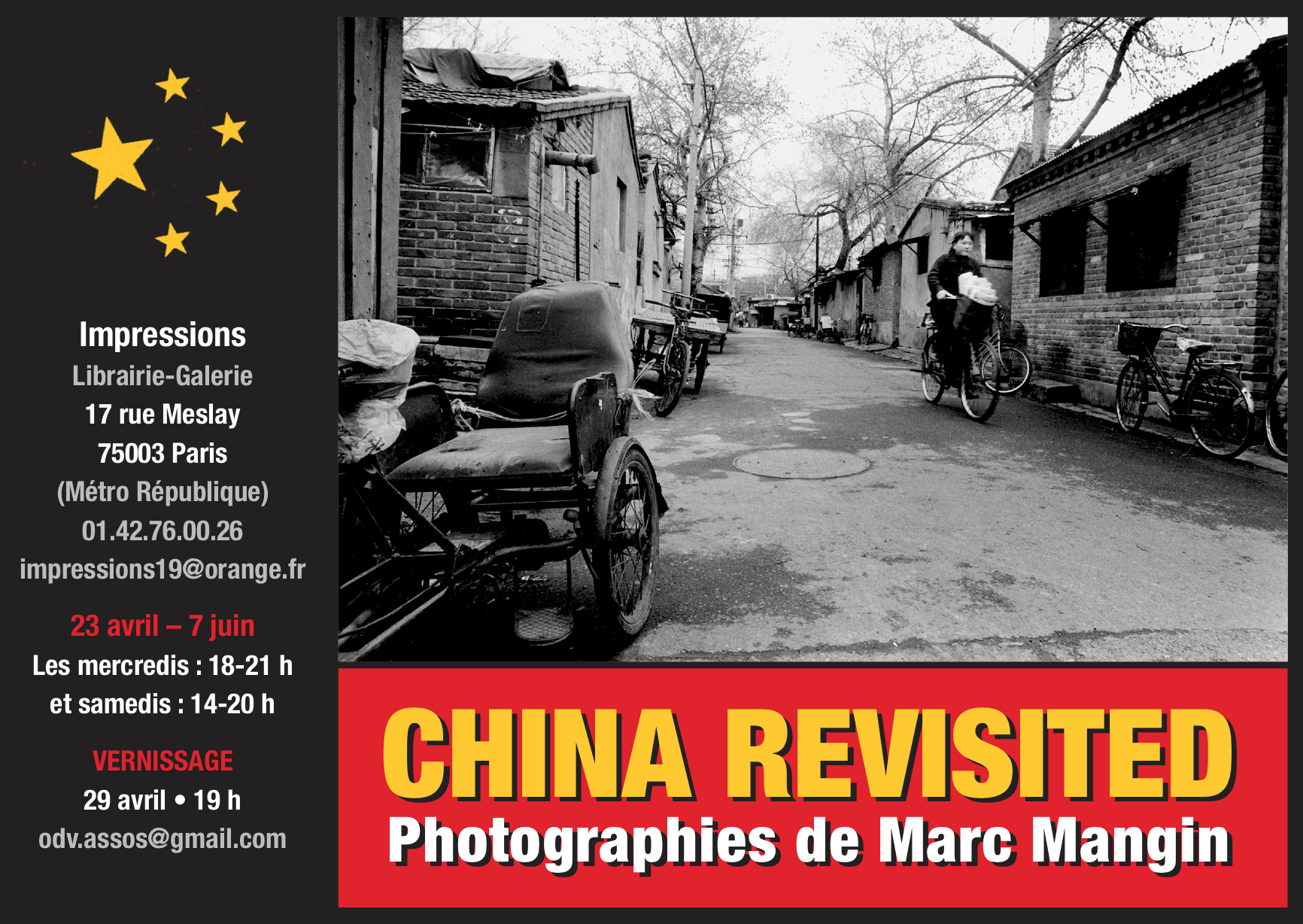Michel Setboun, photojournaliste des agences Sipa Press, Black Star France et Rapho est devenu un auteur de photographies et l’auteur de nombreux livres. Il propose quatre séries d’images dans un endroit original, la Galerie Amarrage, un espace dédié au graffiti, au tag et aux autres formes d’art urbain, situé près des puces de Saint-Ouen.
Le thème général de l’exposition « La vie et rien d’autre » nous fait voyager de Paris à New York. Michel Setboun nous décrit les quatre parties de cet évènement : « Le jour où Paris s’arrêta », « New York en quête d’identité », « New York photographies » et, une fresque photographique sur la vie des biffins au temps de la Covid. Cette partie est « présentée dans un espace privé pour respecter les lois sur le droit à l’image. »
MP
« Le jour où Paris s’arrêta »
Le confinement commence par surprise. Pendant les premiers jours je n’ai pas réagi, comme tout le monde je ne sais pas grand-chose du virus, je suis un peu abasourdi. L’ambiance est vraiment anxiogène. Mais je ne peux pas résister longtemps à l’envie de voir, de photographier Paris, ma ville que je connais si bien, devenue fantomatique à cause d’un virus invisible.
Je commence à sortir timidement. En cette fin d’hiver, Paris fait grise mine. La ville silencieuse et déserte semble mise à nue. Pour tout dire je vois plutôt la vie en noir. En un premier temps, le « noir et blanc » s’impose tout naturellement à mon regard avide de découverte.
Deux semaines plus tard, le printemps fait irruption. Le ciel, lavé de sa pollution, passe au bleu, un bleu lumineux, presque électrique, à en faire mal aux yeux. Les arbres s’habillent de feuilles vertes éclatantes sous un soleil incandescent. La ville abandonnée mais éclaboussée de lumière, resplendit d’une beauté indécente. Je suis tout simplement ébloui par le spectacle. Paris retourne chaque jour un peu plus à l’état sauvage. La ville désertée qui s’abandonne à la lumière dégage un sentiment de paix incroyable. Je n’ai jamais vu ça ! Je suis dans un rêve éveillé, c’est un voyage en imaginaire. Un moment unique, extraordinaire, qui ne se reproduira plus jamais je crois. De temps à autre, une voiture déchire le silence et me fait revenir à la réalité.
Le soir, en rentrant chez moi, après ces heures d’éblouissement, j’écoute la radio qui égrène les souffrances de la population et annonce le bilan morbide de la journée. La nuit, La ville fantôme ressemble chaque jour un peu plus à un décor de science-fiction. Je ne serais pas étonné de voir des zombies débouler au coin de la rue. Dans ces rues désertes, je suis bien loin des gens et des drames humains, je suis loin de tous ces morts dans les hôpitaux. J’ai l’impression de vivre sur une autre planète, loin de la réalité. Ce moment insensé, ce spectacle terrifiant et sublime, n’a duré que quelques semaines.
« La Vie et rien d’autre »
A la fin du confinement, la ville revient lentement à la vie. La cité convalescente n’a plus ce côté désert et magique des premiers jours de la pandémie. Dans le centre de Paris où j’habite, ce semi-confinement au bord de la Seine est supportable mais je me sens loin du monde réel. Je commence à souffrir cruellement de la solitude. Mon univers se rétrécit inexorablement. Au fil des jours, un doute s’installe. Il me manque quelque chose.
A défaut de voyage, je commence à arpenter les quartiers au Nord de la gare du Nord, les banlieues et les quartiers défavorisés, Saint-Denis, Sarcelles, Saint-Ouen, Barbès, Aubervilliers, Belleville, à la recherche de je ne sais quoi exactement, peut-être tout simplement pour y voir du monde, des êtres vivants. J’espère y retrouver mes vieilles habitudes, regarder, chercher, observer, enregistrer les millièmes de secondes du temps qui passe. Je continue à photographier cette période de « faux semblants », pendant laquelle de nombreux magasins sont restés fermés, d’autres sont restés ouverts.
Je croyais connaître par cœur ces quartiers et ces banlieues où j’avais grandi. Mais avec la pandémie, quelque chose a définitivement changé, la misère est devenue plus prégnante, plus palpable, plus visible. Aux portes de Paris, la pauvreté se montre en plein air. Smicards, retraités, handicapés, étrangers, sans-papiers, indigents, chômeurs en fin de droits, mères isolées aux faibles revenus déballent leurs baluchons de fortune sur les trottoirs de ces « marchés de la misère ». Ils sont de plus en plus nombreux, contraints de glaner dans les poubelles ce qu’ils revendront ensuite à un peu moins pauvres qu’eux : chaussures, vêtements usagés, casseroles, lots de piles, tasses, jouets d’enfants.
Mais aujourd’hui avec la pandémie, c’est essentiellement de la nourriture dont la date de péremption est le plus souvent dépassée qui est en vente à même le trottoir, dans les caniveaux. Ici, les yaourts, les fromages ne connaissent pas les frigos, et comme me l’a dit une vieille dame : “ J’en mange et je ne suis jamais tombée malade !”. « Ça vient parfois des associations » me racontent deux autres femmes qui se sont rencontrées près de chez elles. Dans ce petit monde de Zola, tout se vend, tout s’achète pour quelques sous : le pot de Nutella se négocie à 1 €, le vendeur tente de le revendre un peu plus loin pour 1,5€, il n’y a pas de petit profit. Depuis plus d’un siècle, on surnomme ces marchés « les marchés aux voleurs ». Mais aujourd’hui ce sont simplement « les marchés de la misère ».
La police passe régulièrement pour limiter les trafics d’objets volés, des vélos, des ordinateurs hors d’âge, mais pas de drogue. La drogue se vend ailleurs. Bien sûr ces gens sont là par nécessité, par besoin d’argent, mais pas seulement. Ces marchés sont aussi un vrai lieu de sociabilité, un moyen d’échapper à l’isolement, à la solitude. On se réchauffe, on se parle, on se rassure, on partage avec d’autres gens qui sont dans le même dénuement. Vivre seul est un luxe. Surtout sentir que l’on n’est pas seul. La survie au quotidien passe avant l’angoisse du lendemain.
Cela me fait du bien de les entendre crier avec ironie : « Covid à vendre, un Euro ». C’est un cri du cœur. La nuit, les SDF sont les seuls humains à errer dans les rues désertes.
Le soir, je rentre chez moi le plus souvent déprimé. Mais chaque matin je ressens à nouveau le besoin impérieux de retourner sur le terrain. A nouveau errer dans les rues. Au bout de quelques semaines, je me rends compte que ces voyages me font curieusement aussi du bien, je suis moi aussi un humain qui a besoin de se réchauffer au contact des autres. Un homme parmi les hommes qui vient inlassablement puiser cette énergie vitale qui me fait si cruellement défaut. Je suis un des leurs, on me salue : « Comment ça va Tonton ? ». (Tonton est le nom qu’on donne aux plus âgés). Je prends mon café dans des petits bouibouis semi clandestins. Ici le présent et le passé ne comptent pas. La vie s’écrit seulement au présent. Manger, trouver un endroit où dormir.
Je ne vois plus la misère mais simplement la vie qui jaillit, une formidable envie de se battre pour le respect de soi et pour vivre tout simplement. A Saint-Ouen, les Puces sont restées fermées pendant des mois pendant lesquels les biffins ont occupé tout l’espace qui leur est d’ordinaire inaccessible. Cette misère qui d’habitude se cache dans les moindres recoins de la ville, peut s’étaler au grand jour avec en arrière-plan, un décor grandiose créé par des artistes de rue et des graffeurs. C’est beau et spectaculaire. Je n’ai pas besoin de me déplacer au bout du monde pour raconter les histoires des autres. Cette fois-ci, le bout du monde est juste devant ma porte. Et bien sûr, il m’est impossible de résister à l’envie de photographier. Mais c’est une autre histoire.
« Photographier »
Enfant, j’habitais rue des Pyrénées, dans le 20ème arrondissement, aux portes de Paris, juste au-dessus de la petite ceinture dans un monde aujourd’hui disparu, à quelques encablures de « la zone ». Cinquante ans plus tard, avec la pandémie, j’assiste à la renaissance d’une nouvelle « zone », une « nouvelle » population pauvre et marginale vit dans les interstices de la ville. Les nouveaux « zonards » sont des « laissés-pour-compte », des migrants, des pauvres, des sans-abris, des vieux. Ce peuple en marge, a retrouvé ses gestes d’antan, à Montreuil, à Saint-Ouen, à Clignancourt et dans tous les marchés populaires de la capitale, c’est le domaine des marchés des « biffins », les chiffonniers des temps modernes qui vendent ce qu’ils récupèrent dans les poubelles.
Je me suis senti obligé de raconter cette histoire, d’enregistrer des images au moins pour le futur, mais dès le début, je me suis confronté à deux problèmes.
Comment photographier dans ces quartiers où les appareils photo ne sont pas les bienvenus ? Demander aux gens une permission est compliqué car ils sont bien souvent sans papiers, clandestins ou étrangers. Mais mon but est surtout de montrer la vie dans toute sa simplicité et sa brutalité, surprendre des regards, enregistrer quelques millièmes de secondes de cette vie qui passe et à laquelle on ne fait plus attention. Des images sans mise en scène.
Le deuxième problème est que mes images sont impubliables à cause des lois françaises qui portent improprement le joli nom « de droit à l’image ». Ce pays qui revendique être le berceau de la liberté a inventé une jurisprudence qui interdit tout simplement la publication des images.
Si on appliquait ces mêmes règles aujourd’hui à toutes les images qui ont construit notre mémoire collective, par exemple les enfants dans les rues de Doisneau, la photo de la petite fille brûlée et nue au Cambodge, les camps nazis etc. Toutes ces images seraient passibles aujourd’hui d’un recours au tribunal… Aujourd’hui, pour éviter les procès, les êtres humains sont floutés dans les magazines ou les documentaires vidéo.
Par un étrange retournement de situation, on accuse les photographes de porter atteinte à la dignité humaine, mais ce ne sont pas les images qui portent atteinte à la dignité humaine, c’est la situation dans laquelle se trouvent les personnes photographiées. Personne ne réagit à ces atteintes à la liberté d’expression et au droit à l’information. Cela fait des années que j’essaie d’alerter sur ce sujet, mais même les instances professionnelles ne réagissent pas, tout le monde semble accepter cette censure sans sourciller.
Pour respecter les lois sur le « droit à l’image » ou plutôt l’interdiction de montrer mes images en public, mes images seront présentées dans un espace privé, fermé, accessible sur invitation, un genre de « salon rose ». Vous ne verrez pas non plus mes images dans un magazine ou dans un livre, la seule fois où cela s’est produit les visages étaient floutés. Je tenais absolument à exposer ces images à quelques centaines de mètres du lieu où je les ai réalisées. Doit-on se crever les yeux pour ne plus voir l’inacceptable ?
Michel Setboun
Tous nos articles concernant Michel Setboun
Images et créations graphiques de Michel Setboun
Du 5 au 29 mai 2022 de 14h à 19 h
88 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen
Bus 85 – Arrêt marché Paul Bert – Métro : Garibaldi (M13), Porte de Clignancourt (M4)
Michel Setboun sera présent à la galerie les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 26, 27, 28, 29, mai 2022.
Le jeudi 12 mai à 19h Rencontre avec l’auteur sur le thème « La liberté d’information confrontée au droit à l’image »Dernière révision le 8 octobre 2024 à 6:45 pm GMT+0100 par
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi











 Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ?