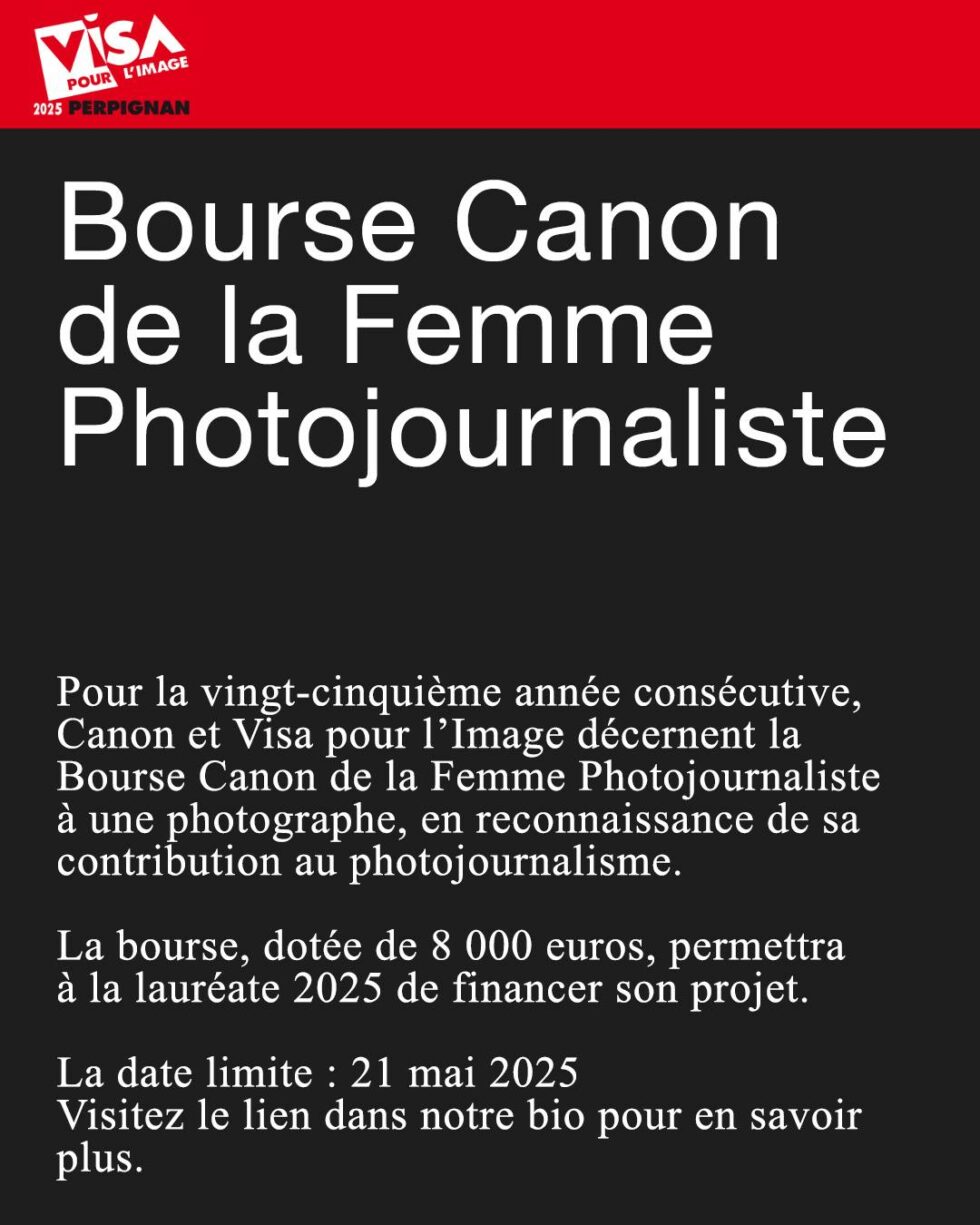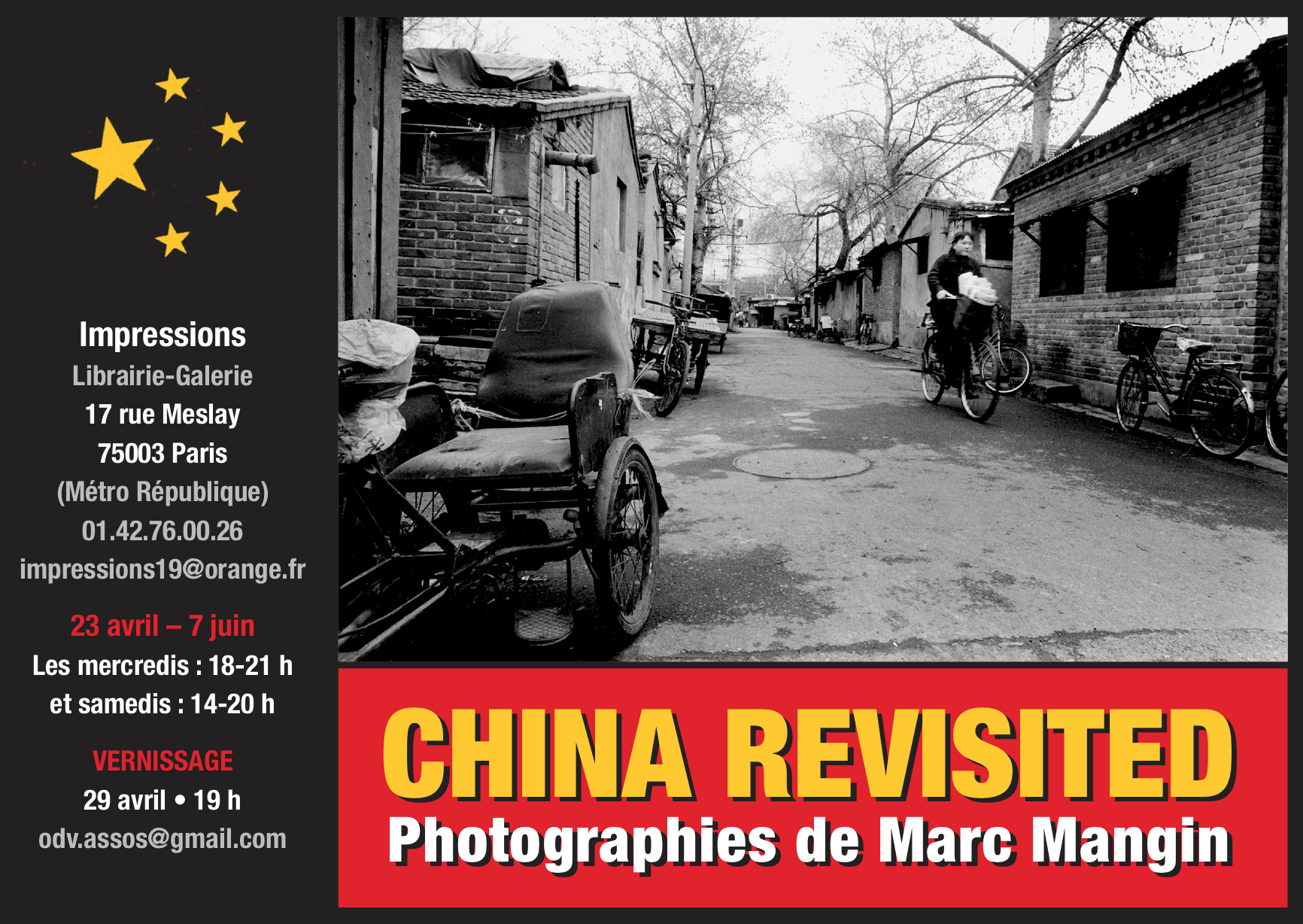Dans le cadre de la Saison France-Portugal qui se tient simultanément dans les deux pays entre février et octobre 2022, la Villa Tamaris, à La Seyne-sur-Mer, centre d’art de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), accueille jusqu’en septembre 2022, une exposition essentiellement consacrée à la photographie portugaise. C’est l’occasion de découvrir un photojournaliste et un éditeur photo très connu au Portugal, mais un peu moins en France.
Petit-fils et fils de photographes, Alfredo Cunha ne voulait pas suivre les traces de la famille, mais le 25 avril 1974, il a vingt ans et la « Révolution des œillets » va changer le cours de sa vie et en faire un pilier du photojournalisme portugais. Nous reproduisons ici des extraits de l’interview d’Alfredo Cunha par Sara Otto Coelho pour l’Observador. MP
« Je ne pense pas avoir très bien
photographié le 25 avril »
Alfredo Cunha

 Enfant, Alfredo Cunha avait une certitude dans la vie : il ne voulait pas être photographe. Adolescent, Alfredo se rend compte que photographier ses amis n’est pas sans intérêt. Puis, dans sa phase hippie, il shoote les concerts et les festivals d’un pays encore sous la dictature, mais, où le vent du changement se fait déjà sentir.
Enfant, Alfredo Cunha avait une certitude dans la vie : il ne voulait pas être photographe. Adolescent, Alfredo se rend compte que photographier ses amis n’est pas sans intérêt. Puis, dans sa phase hippie, il shoote les concerts et les festivals d’un pays encore sous la dictature, mais, où le vent du changement se fait déjà sentir.
Aux premières heures du 25 avril, sa mère lui téléphone pour qu’il écoute à la radio « Ici, le commandement des forces armées ». Il appelle immédiatement le journal O Século [1], où il a travaillé, prend ses appareils photo Nikon F et se rend à Terreiro do Paço [2], avec l’énergie inépuisable de ses 20 ans alliée à l’adrénaline.
Ne sachant toujours pas si le coup est « de gauche » ou « de droite », il pointe ses objectifs vers tout ce qu’il peut. « J’aurais dû photographier davantage », déplore-t-il. Des 40 films sont sorties certaines des images les plus emblématiques de la « Révolution des œillets ». « Si j’avais été plus âgé, j’aurais eu le discernement de désobéir parfois et de faire plus de choses », déplore Alfredo Cunha. Être connu comme le photographe du 25 avril 1974 est un honneur et une croix, admet l’homme qui ne peut pas s’arrêter, qui ne sait pas se taire. Il a suivi de près la décolonisation, a couvert la guerre en Irak en 2003, a vu la chute de Ceauşescu en Roumanie.
Il a été à la fondation du journal Público [3], est passé par les trois agences de presse portugaises – ANOP, ANP puis Agência Lusa [4], les magazines Focus [5] et Visão [6], les magazines 24 Horas, Comércio do Porto [7], Tal & Qual [8], Jornal de Notícias [9], a aidé à fonder « un monstre » appelé Global Images. Il a pris sa retraite en 2012, très en colère contre le journalisme. « Il n’y a plus de reportage, il n’y a rien. Les patrons sont des connards », dit-il…/…
Il a également été photographe officiel de deux présidents de la République, d’abord Ramalho Eanes, puis Mário Soares. …/… En 1991, il a rencontré sa compagne actuelle, Maria Fernanda, lors d’un reportage en Roumanie. Elle était médecin, il était photojournaliste à Público, et accompagnait le journaliste Luís Pedro Nunes [10]. Au cours de ce voyage, ils ont eu un très grave accident de la route qui a laissé à Alfredo Cunha de mauvais souvenirs jusqu’à aujourd’hui. Mais cet accident l’a rapproché de Fernanda. Quant à Luís Pedro Nunes il a gagné un prix avec le reportage. Alfredo, lui, a gagné un heureux mariage.
L’interview

Dans le salon où vous travaillez, vous avez les murs tapissés de photos prises par vous mais aucune de vous, de votre visage. La séance photo pour l’Observador a été pénible. « Est-ce fini ? Est-ce assez ? » disiez-vous en admettant que vous ne saviez pas comment vous tenir devant un appareil photo ! Les étagères sont pleines de livres et de magazines photo et de disques ; de nombreux disques, en particulier de jazz et de rock. Parce que le jeune hippie du début des années 70 est toujours là ?
Né en 1953 à Celorico da Beira (Guarda,Portugal), vous avez vécu trois ans au Brésil, puis installation dans La Guarda. Est-ce l’amour qui vous a amené à quitter Lisbonne ?
Ma femme vivait aussi avec moi à Lisbonne. Elle est originaire de Guimarães et a de la famille dans la région. Cette ferme a été abandonnée, nous l’avons achetée et nous avons récupéré la maison. Nous sommes mariés depuis 25 ans et nous vivons ici depuis 20 ans.
Était-ce un grand changement, quitter la capitale et travailler à partir d’ici ?
Oui, mais j’ai toujours travaillé partout d’ici. Je n’ai jamais cessé de voyager, d’aller dans des endroits. Encore plus que lorsque j’habitais à Lisbonne. Demain j’y vais, puis je vais à Funchal, le 26 avril je vais à la Guarda… Et puis je dois m’arrêter un peu parce que je commence vraiment à être fatigué.
Quand avez-vous vu votre femme pour la première fois ?
Dans un avion TAP en route pour Bucarest en 1991. Elle était médecin humanitaire et j’allais avec Luís Pedro Nunes pour faire une histoire en Roumanie.
Au cours de ce reportage, vous avez eu un grave accident de voiture.
Oui, c’était un accident très violent, nous sommes passés sous un camion et nous avons eu beaucoup de chance, moi, Luís Pedro Nunes et Domingos Amaral, fils de Freitas do Amaral [11]. J’ai encore des suites aujourd’hui…
Je me suis cassé un genou, cassé l’épaule, cassé le bras, fracturé la cage thoracique, cassé beaucoup de choses. Nous étions en route vers une usine de pneus, qui était l’endroit le plus pollué au monde à l’époque, pour faire ce reportage en Albanie, près de la frontière avec la Roumanie.
Nous allions à 180 km/heure, la voiture était en mauvais état. Même aujourd’hui, je ne comprends pas comment quelqu’un n’est pas mort, c’était un miracle. Cet accident a interrompu ma vie pendant près d’un an.
Fernanda était l’un des médecins pour vous aider ?
Oui, les médecins de son association sont venus voir si nous avions besoin de quelque chose quand nous étions à l’hôpital roumain, ce qui était un peu délicat… Ils sont venus pour nous soutenir. Quand elle est revenue au Portugal, elle a pris de mes nouvelles pour savoir comment j’allais. Nous avons parlé un peu plus, puis déjeuner, dîner, vous savez comment se passent ces choses-là, n’est-ce pas ? [Rires]
Quand il a divorcé, Mário Soares vous a-t-il donné quelques conseils ?
Oui, oui, oui, oui ! Il m’a dit : « Regarde ce que tu peux encore faire ! », mais je ne voulais plus rien faire. Et il a dit : « Oui, maintenant tu vas trouver une autre façon de vivre, plus familiale, et c’est la même chose. » Et d’autres conseils qui ne peuvent pas être dits ici maintenant. [Rires]
Parmi ces conseils, il s’agissait d’acheter une Porsche ?
Non, j’ai acheté la Porsche quand j’étais plus jeune. Je l’ai achetée parce que j’ai toujours voulu une Porsche. J’ai toujours aimé vivre mes rêves. Je voulais avoir une Porsche. Mon premier rêve était un Nikon F, un appareil mythique que j’ai encore. Il y a un rêve que je n’ai pas encore réalisé, c’est d’avoir une montre Breitling. Et il y a un autre rêve : avoir une Jaguar.
Vous êtes le petit-fils d’un photographe appelé Alfredo Cunha, le fils d’un photographe. La photographie était-elle toujours si présente que vous ne pouviez faire autre chose ?
Je ne voulais pas être photographe parce qu’enfant, j’avais sept ou huit ans, je devais travailler, le week-end pour aider mon père pour les photos de mariages. Et je ne voulais pas devenir photographe, pour moi, c’était de l’esclavage. Puis j’ai commencé à photographier.
Et puis ?
J’ai commencé par photographier mes amis [rires]. Je n’avais pas de voiture, mais j’avais un appareil photo. J’ai encore mon premier boitier, acheté avec mon salaire. C’est un Petri FT, il a coûté quatre dollars et cinq cents.
Votre grand-père, votre père, vous ont-ils prodigué des conseils que vous utilisez encore aujourd’hui pour photographier ?
Mon père avait une vision très utilitaire de la photographie. Il me disait : « Ne fais pas de choses inutiles. » Il n’aimait pas les choses abstraites, il aimait les choses concrètes, il avait une vision complètement commerciale de la photographie.
Parlez-moi de votre enfance. Étiez-vous un bon élève ?
Je n’étais pas un bon élève. Je pense que j’étais un enfant intelligent, mais j’étais toujours trop libre, et ni mon père ni ma mère ne m’imposaient de discipline. J’allais à l’école, j’allais à la rivière, j’allais voir les oiseaux…
Avec qui avez-vous vécu à Celorico da Beira ?
Avec mes parents et mes frères. Nous étions quatre. J’ai eu une enfance fantastique, ce qui m’a apporté une grande expérience. J’ai appris dès mon plus jeune âge que je devais m’en sortir. J’ai appris à me défendre.
Parlait-on de politique à la maison ?
Oui, il parlait… il parlait… Un de mes frères était d’extrême gauche, moi j’étais au parti communiste… Mon père n’était pas en faveur du régime, même s’il n’avait pas une position très définie. Et puis il y avait ma mère, qui était le centre de l’équilibre de la maison, le facteur d’unification, qui gérait les différentes sensibilités.
Quand avez-vous quitté votre pays natal ?
Je suis parti la première fois quand j’avais cinq ans nous sommes allés au Brésil, où nous sommes restés trois ans à Campo Grande, dans l’État du Mato Grosso. Je me souviens de tout, je suis allé à l’inauguration de Brasilia ! Ensuite, j’ai vécu à Mangualde, puis à Guarda, puis à environ 15 ans, je suis allé à Lisbonne. J’ai vécu dans beaucoup d’endroits parce que mon père déménageait souvent. Je changeais donc d’amis et m’inscrivais dans de nouvelles écoles, ce qui m’a donné une certaine instabilité mais m’a aussi donné une plus grande adaptabilité.
Était-ce agréable d’être un adolescent à Lisbonne à la fin des années 60, au début des années 70 ?
C’était super ! Mon adolescence était une autre fête, j’étais hippie !
Il y avait des festivals et des concerts donc…
Je suis allé aux festivals de Vilar de Mouros, aux concerts à Cascais, j’étais un habitué de tous les lieux de rock.
Le premier journal où vous avez travaillé est le Notícias da Amadora, en 1971.
Oui parce que Carlos Carvalhas [12] était le directeur du journal à l’époque.
Peu de temps après vous allez au journal O Século ?
J’ai fait un portfolio et je suis allé là-bas pour le montrer aux photographes, Eduardo Gageiro et Fernando Baião. La mère du Premier ministre, Maria Antónia Palla, m’a accueilli. Et je suis resté là, j’ai collaboré deux mois et puis je me suis mis aux portraits. Elle a été ma première patronne.
Le fait qu’Eduardo Gageiro et Fernando Baião y travaillent a-t-il pesé sur la décision d’aller au Siècle ?
Oui, c’était deux photographes que j’aimais beaucoup, ce sont des références au Portugal ! (Ndlr : Depuis quelques années Eduardo Gageiro, très procédurier, lui fait des procès pour vol de photos !)
25 avril 1974
Le meilleur était la liberté et la démocratie.
Les gens ne peuvent pas imaginer ce que c’est que de ne pas vivre en démocratie, c’est une chose horrible.

Être connu comme le photographe du 25 avril est-il un honneur ou une croix que vous portez ?
Les deux… Je ne suis pas LE photographe du 25 avril, je fais partie des photographes qui étaient là, il y en avait d’autres qui ont effectué un travail très important. Si vous voulez que je vous dise : je ne pense pas avoir très bien photographié le 25 avril.
Que vous a-t-il manqué ?
Je n’aurais pas dû avoir 20 ans… Il aurait fallu que j’ai 30 ans pour avoir plus d’expérience. J’aurais dû photographier davantage.
40 films ce n’était pas suffisant ?
C’est trop peu, j’aurais dû en faire 120 ! Je vais vous parler de deux scénarios très proches : le 25 avril et la décolonisation. Pour la décolonisation, j’ai réalisé ce qui se passait et, quand je l’ai photographiée, je l’ai fait avec une intention précise de couvrir les événements.
Le 25 avril est quelque chose qui s’est présenté et que j’ai photographié. Et puis j’ai dû obéir aux ordres des militaires, j’ai dû aller développer les films, donc j’ai perdu beaucoup de temps. Si j’avais été plus âgé, j’aurais eu le discernement de désobéir parfois et de faire plus de photos. C’est juste que…
Mais, je n’avais que 20 ans ! L’âge d’une partie de l’armée de l’École de pratique de la cavalerie qui a quitté la caserne Santarém le 24 avril et a marché vers Lisbonne.
Rappelez-nous un peu à quoi ressemblait cette journée ?
J’en ai parlé tellement de fois… C’est comme si c’était hier pour moi. Je me souviens de tout, tout est très présent. Parfois, je vais dans les endroits et j’entends les sons de ce jour-là. Je me souviens que la musique de José Mário Branco et Sérgio Godinho était interdite à la radio et ce jour-là je pouvais l’entendre, à la radio, dans la rue. Les gens se sont fait un devoir d’installer la radio devant leurs portes. Je me souviens des paroles d’ordre, des manifestations. Je me souviens d’avoir été surpris par la première manifestation du MRPP [13], contre Spínola, le même jour. « A bas le cambadilha spinaliste » [rires].

Comment s’est passée la première approche de Salgueiro Maia [14]?
Le moment c’est cette photo, j’avais attiré son attention car il ne voulait pas que je me faufile…
Est-ce pour cela que vous préférez cette image du Saule Maya au portrait iconique que vous en avez fait ?
Précisément.
Comment l’abordez-vous pour en faire le portrait ?
Je ne lui ai rien demandé, c’était une conférence de presse à laquelle j’étais en retard, il m’a remarqué. Le portrait a été refusé au O’Secolo et il n’a été publié que 20 ans plus tard, par Vicente Jorge Silva.
Mais plus tard dans les années 80, saviez-vous que vous aviez ce portrait ?
Je l’ai toujours aimé. Et j’étais même un peu outré qu’ils le rejettent. J’ai remarqué qu’au fil des ans, j’ai beaucoup de photographies qui sont devenues des icônes de n’importe quoi. Par exemple, le conteneur représente la décolonisation, une autre de la fin de la guerre civile au Mozambique, puis le Douro, qui est devenu une icône du nord du pays….
Le 25 avril ce matin-là, pourquoi vous êtes-vous levé si tard ?
Je travaillais la nuit et je rentrais tard à la maison. Quand je suis arrivé, je suis allé écouter de la musique avec mon frère, nous parlions et ma mère a dit : « Regardez, il y a quelque chose… Ecoutez la radio… » Quand j’ai commencé à entendre « Ici le poste de commandement des forces armées », j’ai réalisé que le jour était venu. Parce que depuis environ deux mois, on s’attendait à ce qu’il se passe quelque chose. Il pouvait y avoir deux coups, un de gauche ou un de droite… Ce n’est que dans l’après-midi que nous avons été rassurés.
Lorsque vous avez parlé à Salgueiro Maia, n’avez-vous pas réalisé de quel côté il se trouvait ?
Oui, mais je me suis dit : c’est lui… Par exemple, les Marins ont pris le contrôle de la PIDE (ndlr : Police politique) mais, au début, c’était pour les défendre. Parce qu’il y a deux forces marines, et celle qui vient en premier et qui part est venue défendre le régime. Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter…
Que reste-t-il à dire ?
Adelino Gomes a déjà réussi à réunir les perdants et les gagnants, dans le livre The Tank Boys. Mais il reste encore quelques perdants pour raconter leurs histoires. Il y a une histoire que nous pourrions raconter à l’occasion du 50e anniversaire [du 25 avril]. Si nous sommes toujours là.
Du 25 avril quel est le meilleur ?
Le meilleur était la liberté et la démocratie. Les gens ne peuvent pas imaginer ce que c’est que de ne pas vivre en démocratie, c’est une chose horrible.
Et le pire ?
Les gens du gouvernement qui ont vendu le pays. Vendu ! Et ça va être très difficile de le récupérer. Ce n’est pas parce que c’est « de droite » ou « de gauche », c’est parce qu’on n’avait pas à vendre le pays. J’ai une fille qui travaillait en Inde parce que ces « merdes » ont vendu le pays. Elle a fait des études supérieures en relations internationales et en communication stratégique, et ne pouvait pas obtenir un salaire de plus de 600 euros, alors elle est partie. La jeunesse est partie.

Il y a un autre moment qui a marqué votre carrière : la décolonisation.
Pour moi, c’est aussi important que le 25 avril. La Révolution a duré trois jours et la décolonisation a été un travail de plusieurs mois dans différents pays.
Surveiller de près le départ des Portugais et les processus d’indépendance, certains plus tumultueux que d’autres, vous a-t-il affecté ?
Cela m’a beaucoup affecté. Il faut faire attention à ce qui est dit sur la décolonisation, parce que ça s’est fait comme ça pouvait être fait. Les soldats ne voulaient pas prendre des coups. La décolonisation aurait dû se faire quand nous avons gagné la guerre, en Angola et au Mozambique. Surtout en Angola. C’est à ce moment-là qu’il aurait fallu négocier. À partir du moment où les soldats déposent les armes et disent c’est terminé, comment voulez-vous négocier quand il n’y a plus de force militaire ? Il y a eu des erreurs, mais ils ont fait ce qu’ils pouvaient à l’époque. La priorité était de ramener un million de Portugais au pays et c’est chose faite.
Vous avez également suivi de près le PREC (Processus révolutionnaire en cours [15]), l’incendie du Chiado [16] et avez été le témoin de la chute de Ceauşescu en Roumanie, puis de la guerre en Irak en 2003. Vous êtes-vous déjà senti en danger de mort ?
Non… Quand vous avez l’appareil photo devant vous, vous ne mourez jamais, les choses passent à côté [rires]. J’ai un grand ami, João Silva. Il a perdu ses deux jambes. Et il me disait que l’appareil est un danger parce que nous pensons que nous sommes en sécurité. J’ai eu de la chance. Sur cette photo de Nassíria en Irak, Domingos Andrade et moi, avons quitté ce bâtiment en feu une minute avant qu’il n’explose…
C’était juste…
Mais la situation la plus dangereuse que j’ai vécue, c’était à Fatima. Je prenais une photo, vue d’en haut, de la procession avec les bougies. Je suis monté au sommet de la tour. Seulement, alors que je photographiais, la cloche a commencé à sonner très fort et j’ai sauté. En fait, j’ai sauté du bon côté parce que si je sautais en avant c’était fini… C’est là que j’ai eu le plus peur quand j’ai regardé vers le bas….
« Il n’y a plus de reportage, il n’y a rien.
Les patrons de presse sont des connards »
On me dit que vous ne buvez pas, que vous ne fumez pas, que vous ne sortez pas le soir. Que vous êtes à 100% fixé sur le travail. Avez-vous un passe-temps en dehors de la photographie ?
Je fais de l’exercice à cause de ma colonne vertébrale.
On dit aussi que vous ne laissez personne toucher vos boitiers, même si c’est pour vous alléger.
Je ne laisse vraiment personne manipuler mon équipement. C’est juste, que chaque fois que quelqu’un y touche, il change n’importe quoi.
Est-il vrai que lorsque vous allez en reportage, vous vous réveillez à 7h du matin pour travailler et restez jusqu’à minuit pour voir le résultat de votre travail ? On m’a décrit un Alfredo Cunha obsédé par le travail qui doit prendre 1 000 photos par jour.
1 000 au moins [rires]. Ç’est ce qu’il faut. L’autre jour, j’ai eu une discussion avec Luís Pedro [Nunes] au Népal, pour un reportage pour L’Expresso. En fait, nous nous étions un peu fâchés – et retrouvés le même jour – parce que nous perdions un temps précieux à supporter un imbécile ! À un moment donné, je me suis levé et j’ai dit : « O Louis Pedro, je ne supporte plus ce type. Nous sommes venus de l’autre bout du monde, ce n’est pas nécessaire d’être ici pour écouter ça. » Je me suis levé et je suis parti. Luis Pedro était furieux.
Vous avez pris votre retraite en 2012 mais vous avez d’autres projets. Pourquoi vouliez-vous quitter le journalisme ?
Je perdais mon temps. Je travaillais et gagnais de l’argent, mais je perdais mon temps.
Pourquoi n’y a-t-il plus de place pour de grands reportages ?
Il n’y a plus de reportages, il n’y a rien. Il ne s’agit que de supporter de mauvais patrons, de supporter des gens qui paient avec de l’argent emprunté à la banque et qui ne paient pas la banque… Une chose étrange ! Et je ne veux plus supporter ces gens. Je parle de ces gens, qui, je crois, ont un comportement de délinquants. Ils ont détruit des institutions, fermé des journaux et des magazines, il semble que là où ils mettent la main, ils détruisent et gagnent de l’argent. Une chose incroyable. Je ne veux plus me soucier de ces gens, alors je suis parti. J’ai produit plus depuis que j’ai cessé d’être journaliste qu’au cours des 10 dernières années de ma carrière.
Ces extraits sont de ©Sara Otto Coelho pour l’Observador que nous remercions.
Adaptation de Michel Puech
Vous pouvez lire l’intégral en portugais sur le site de l’Observador
Alfredo Cunha: “Acho que não fotografei muito bem o 25 de Abril”
Exposition
Un été au Portugal
du 4 juin au 18 septembre 2022
Commissaires d’exposition : Micheline Pelletier et Rui Freire
Villa Tamaris Centre d’Art Toulon Provence Méditerranée
295, avenue de la Grande Maison – 83500 La Seyne-sur-mer – Site web : https://www.villatamaris.fr/
Notes
[1] O Século (Le Siècle) était un quotidien portugais de référence publié à Lisbonne de 1881 à 1977.
[2] Praça do Comércio, encore communément désigné par son ancienne désignation de Terreiro do Paço, est une place du centre-ville de Lisbonne située au bord du Tage, dans la zone qui a été le site du palais des rois du Portugal pendant environ deux siècles et qui est aujourd’hui en partie occupée par certains ministères.
[3] Público est un quotidien portugais né le 5 mars 1990, propriété du groupe Sonae
[4] Agência de Notícias de Portugal (Lusa) est une agence de presse portugaise et la plus grande de la Lusophonie. L’agence a été fondée en décembre 1986 comme une société anonyme à Lisbonne, remplaçant les agences NP et ANOP (celle-ci ayant à son tour succédé à l’ANI, fondée en 1947). Son principal actionnaire est l’État portugais. Son siège et le bureau central sont situés rue Dr João Couto, dans le quartier de Benfica, à Lisbonne. Lusa diffuse des informations nationales et internationales, dans le monde entier, pour des journaux, magazines, radios, télévisions et sites web. L’agence compte 280 journalistes à son service et des délégations dans 24 pays.
[5] Focus était une édition sous licence de l’hebdomadaire allemand du même nom. Comme son homologue allemand, ce magazine voulait traiter de questions d’actualité, du monde, de l’argent et des histoires de vie.
L’édition portugaise a été lancée le 25 octobre 1999 avec 60 000 exemplaires. En 2010, il a maintenu une édition d’environ 30 000 exemplaires. L’édition portugaise du magazine Focus a été interrompue en janvier 2012.
[6] Visão a été publié pour la première fois le 25 mars 1993. Le magazine est le successeur de l’hebdomadaire O Jornal publié entre 1975 et 1992.
[7] Comércio do Porto (Le commerce de Porto) était un journal Portugais, fondée le 2 juin 1854. Lorsqu’il a cessé de publier, en 2005, il était le deuxième plus ancien journal portugais.
[8] Tal & Qual (Just Like That) est un tabloïd hebdomadaire portugais publié entre 1980 et 2007 puis reparu en 2021. L’hebdomadaire est basé à Lisbonne.
[9] Jornal de Notícias, également connu sous le nom de JN, est un quotidien portugais fondé en 1888 à Porto.
[10] Luís Pedro Nunes est un journaliste, fondateur de Público en 1989, reporter puis rédacteur en chef jusqu’en 1997. En 1991, il a remporté le prix Gazeta Revelação avec un reportage sur les enfants en Roumanie.
[11] Freitas do Amaral est un homme d’État portugais chrétien-démocrate, né le 21 juillet 1941 à Póvoa de Varzim (Porto) et mort le 3 octobre 2019 à Cascais (Lisbonne).
[12] Carlos Carvalhas est un intellectuel portugais qui a soutenu le combat des étudiants contre la dictature de Salazar. Membre du Parti Communiste Portugais (PCP) il deviendra ministre du travail après le 25 avril 1974, puis succédera à Alvaro Cunhal et se présentera à l’élection présidentielle de 1991 et sera battu par le socialiste Mario Soares.
[13] Le Parti communiste des travailleurs portugais (PCTP/MRPP), est un parti politique portugais d’inspiration maoïste, fondé le 26 décembre 1976 à partir du Mouvement réorganisateur du Parti du prolétariat (MRPP)
[14] Fernando José Salgueiro Maia (Castelo de Vide, Portalegre 1er juillet 1944 — Santarém, 4 avril 1992) était un capitaine de l’armée portugaise qui a joué un rôle prépondérant lors de la Révolution des œillets qui fit tomber le régime dictatorial.
[15] Le Processus révolutionnaire en cours (en portugais : Processo Revolucionário Em Curso), parfois désigné comme Période révolutionnaire en cours, ou encore plus fréquemment par le sigle PREC, désigne la période des activités révolutionnaires née de la révolution des Œillets, le coup d’État militaire du 25 avril 1974 qui renverse la dictature au Portugal, et conclue après l’adoption de la nouvelle constitution portugaise en avril 1976.
[16] « Pour tous les Portugais, le réveil dans la matinée du jeudi 25 août 1988 restera un cauchemar. Le violent incendie qui s’est déclaré dans les grands magasins Grandela, au cœur du vieux Lisbonne, s’est étendu à une vitesse impressionnante aux rues avoisinantes et a ravagé au moins quinze immeubles de grande importance historique de la Baixa Pombalina. Ce sinistre a causé au patrimoine culturel et historique du Portugal les dommages les plus graves depuis le tremblement de terre du 1er novembre 1755 » Le MondeDernière révision le 9 octobre 2024 à 9:42 am GMT+0100 par
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi










 Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ?